

 (0)
(0)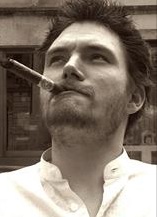
Philosophe et essayiste, David L'Epée est avant tout un intellectuel indépendant et collabore aux revues Éléments, Rébellion et Krisis dont il est le rédacteur en chef.
Spécialisé dans l'histoire du socialisme et les débats autour de la démocratie directe, il intervient régulièrement pour dénoncer les métamorphoses de l'idéologie déconstructionniste qui ravage nos sociétés, que ce soit la cancel culture, le wokisme ou la théorie du genres.
Émission "La Méridienne", animée par Wilsdorf et Jean-Louis Roumégace.


 (0)
(0)
On a parfois reproché au philosophe sa méconnaissance de l'art et de son histoire. On peut également reprocher à l'histoire de l'art de ne pas avoir mesuré que l'art n'est pas seulement constitué d'oeuvres mais aussi de mots pour les dire, de concepts pour les catégoriser, de théories pour les penser. Car si la philosophie de l'art sans histoire de l'art est vide, l'histoire de l'art sans philosophie de l'art est aveugle.
C'est à partir de ce double constat que Carole Talon-Hugon a entrepris d'élaborer une histoire philosophique de l'art occidental, depuis l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours : autrement dit d'étudier le développement des arts et la succession des styles en relation avec l'atmosphère théorique où ils se sont produits, et de dessiner les contours des grands paradigmes artistiques qui se sont succédé.


 (0)
(0)
Un monde dans lequel des innocents souffrent peut-il avoir un sens ? Si la question du mal est éminemment philosophique, c'est qu'elle n'est pas seulement morale : elle interroge l'intelligibilité du monde. S'intéresser aux réponses qui y ont été apportées par les philosophes, c'est comprendre intimement leur manière de voir le monde, en écho à celle de leur époque. C'est aussi saisir que nous sommes toujours pris dans des carrefours de postulats qui nous dépassent.
Lorsqu'en 1755 Lisbonne est détruite par un tremblement de terre, l'événement provoque une onde de choc parmi les philosophes européens. Ce que l'on qualifierait aujourd'hui de catastrophe naturelle est considéré comme l'incarnation du mal. Deux siècles plus tard, la découverte des camps de la mort nazis agit comme une dévastation conceptuelle : la plupart des philosophes s'accordent à dire que nous manquons de ressources pour aller au-delà du témoignage. De "mal naturel", le mal est devenu "mal moral" ; une bascule a eu lieu.
Susan Neiman, en philosophe, fait le récit de cette bascule.
Émission "Signes des temps", animée par Marc Weitzmann.


 (0)
(0)
L'Occident, en tant qu'entité politique, continue a céder du terrain sur le plan géostratégique, du fait de la montée en puissance d'acteurs tierces et d'erreurs internes qui l'ont affaibli.
Petit tour d'horizon de la situation actuelle en compagnie du politologue et expert en stratégie militaire suisse Bernard Wicht.


 (0)
(0)
"En Algérie, nous combattions pour nous-mêmes, pour notre droit à un destin, pour notre dignité. Nous combattions pour relever le défi des défaites passées, pour effacer l’humiliation intolérable et la douleur. Nous combattions pour garder notre bien, pour conserver une terre acquise par le droit de conquête, de sang, de sueur et de colonisation. Nous combattions pour défendre sur cette terre, nos berceaux et nos cimetières. Nous combattions pour protéger les nôtres en danger", dit Dominique Venner dans Le Cœur rebelle.
Cinquante ans après les faits, avec le recul que l'on attend de l'historien, il est temps de revenir sur les années fiévreuses de la guerre d'Algérie, évaluer le rôle du général de Gaulle et s'interroger sur le sens que la révolte des généraux a pu avoir.
Émission du "Libre Journal des historiens", animée par Philippe Conrad.


 (0)
(0)
Philosophe, journaliste, poète, traducteur et acteur de la vie politique française, Pierre Boutang (1916-1998) était tout cela à la fois.
Il a traversé le XXe siècle avec toujours un livre dans la poche, et revient dans cet entretien sur son parcours, de l'Algérie à cause monarchique en passant par Maurras et De Gaulle, et son oeuvre, de la question du temps à notre rapport au langage poétique.


 (2)
(2)
Elias Canetti, né à Roussé (en Bulgarie le 25 juillet 1905 et mort le 14 août 1994 à Zurich en Suisse), est un écrivain d'expression allemande, originaire de Bulgarie, devenu citoyen britannique en 1952 et qui a longtemps résidé en Suisse. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1981.
Canetti est souvent associé à la littérature autrichienne mais il couvre une perspective plus large. Son œuvre a défendu une idée pluraliste de la culture européenne dans sa richesse et sa diversité, liée à un parcours de vie singulier. Il est l'auteur d'analyses de grande envergure sur le XXe siècle et de réflexions détaillées sur les mécanismes humains et les modes de fonctionnement psycho-sociaux.
Retour sur la trajectoire d'Elias Canetti, l'éveilleur d’un futur antérieur.
Émission "Une vie, une oeuvre".


 (0)
(0)
Une question revient inlassablement au sujet de l'esclavage dans le monde grec : comment peut-on imaginer que des penseurs comme Socrate ou Aristote n'aient jamais dénoncé, et aient même apporté leur caution, à ce crime contre l'humanité qu'est l’esclavage ?
Cette question est en réalité absurde. Gageons même qu'elle aurait été proprement inaudible aux hommes de l'Antiquité. Les auteurs antiques ont reconnu l'universalité de la raison humaine, en affirmant même la commune égalité et liberté de tous les hommes, certes, mais leur universalisme n'a jamais conduit à remettre en cause l'esclavage. Ils n'ont même jamais conçu que l'égalité "naturelle" entre les hommes puisse se traduire positivement dans le droit et, dès lors, dans la société de leur temps.
Et pourtant, on chercherait en vain un corps de doctrine ou un grand récit par lequel ces penseurs ont entrepris de légitimer l'esclavage. C'est que la domination esclavagiste en Grèce ancienne ne se justifiait pas d'un ordre de légitimité extérieur. Ni la prétendue supériorité d'une race ni l'autorité des dieux ne justifiaient en elles-mêmes l'existence de l'institution esclavagiste.
L'esclavage relevait d'une catégorie de choses déconcertantes pour le raisonnement historien : celle des institutions dont l'être ou le non-être ne prêtait pas au débat. Comment saisir dans ce cas la pensée grecque de l'esclavage ?


 (0)
(0)
Le 16 mars 1978, via Fani, à Rome, le président de la Démocratie chrétienne Aldo Moro est brutalement enlevé par un commando armé, et les cinq hommes de son escorte tués. Au coeur de ces années de plomb qui voient se succéder en Italie attentats d'extrême droite et d'extrême gauche, dans un climat de désordre et de guerre civile, la revendication de cet acte de terrorisme est rapide : il est le fait des brigades rouges - trois hommes et une femme, qui pendant 55 jours retiendront l'homme d'État séquestré dans un appartement du centre ville.
Que retenir de cette affaire et, plus largement, de cette période qui témoigne dun affrontement larvé entre les services secrets de l'Est et de l'Ouest, les organisations mafieuses, les loges maçonniques et diverses radicalités politiques emblématiques de l'époque ?


 (0)
(0)
Souvarine : ce nom évoque Germinal. Un jeune militant pacifiste et socialiste -Boris Lifschitz- l'emprunte en 1916 à Emile Zola. Devenu Boris Souvarine, il est l'un des principaux acteurs de la fondation du Parti communiste en France (1920). Lénine lui accorde sa confiance et, malgré son "indiscipline", le hisse aux plus hautes instances de l'Internationale communiste.
Pourtant ce jeune révolutionnaire, passionné de culture, est l'un des tout premiers à rompre -en 1924- avec Moscou. Alors commence pour lui une lutte incessante contre la dégénérescence du bolchevisme, le mensonge et l'impérialisme soviétique.
Premier biographe du maître du Kremlin - Staline, aperçu historique du bolchevisme (1935), un ouvrage capital -, il est conduit par son intrépide critique de l'expérience russe à retrouver les fondements moraux de l'action politique.
D'un courage hors du commun, à contre-courant de tous les terrorismes intellectuels, il n'a jamais abdiqué, même face à Trotski qu'il admirait. Ami de Simone Weil qu'il influença, profondément attaché au peuple russe, Boris Souvarine, témoin essentiel dans un siècle marqué par le complicité des totalitarismes nazi et soviétique, a combattu pendant cinquante ans pour une seule cause : la vérité en politique.


 (0)
(0)
Si l'écologie a pour objectif d'étudier les rapports entre un organisme et le milieu naturel, et se donne à cette fin les outils d'une science, elle ne peut ignorer les facteurs qui influent sur ces rapports complexes, lesquels ne sont pas "naturels" mais tiennent à des données sociales, culturelles, économiques, politiques. Aussi, de l'intersection de l'écologie et des sciences sociales ou économiques, est née l' "écologie politique", terme forgé en 1935 par le physiologiste américain Frank Thone mais utilisé surtout à partir des années 70.
En France, différentes tendances peuvent être observées, que Serge Audier présente ici par l'intermédiaire de trois de ses principaux représentant : Bertrand de Jouvenel, Bernard Charbonneau et André Gorz.


 (0)
(0)
Récemment réédité aux Éditions du Seuil, le cours du Collège de France sur la question du Neutre donné en 1978 par Roland Barthes constitue une expérience de pensée sans conclusion. Impraticable, le Neutre n'est pas pour autant un non-agir, mais l'affirmation d'un être qui ne s'empresse pas de trancher. Le neutre n'est jamais atteint de manière définitive, il est une démarche à reprendre, à redésirer.
Retour, en compagnie d'Eric Marty et Benoit Peeters, sur cette position de sécession, d'opposition ou de recul qui crée une forme de distance, de mise entre parenthèses des opinions dominantes, voire du sens.
Émission "Avec philosophie", animée par Géraldine Muhlmann.