

 (0)
(0)
La découverte des antibiotiques constitue une des plus grandes avancées scientifiques du XXème siècle. Durant l’âge d’or qui a suivi, ces médicaments miracles ont sauvé des millions de vies.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation inédite, celle de voir un immense progrès pour l’humanité disparaître devant l’évolution des bactéries et l’absence d’innovations.
Les bactéries ont rapidement muté ces dernières années sous l’effet des traitements multiples, de l’automédication, des indications contestables, des erreurs de posologie. De plus en plus résistantes aux antibiotiques, elles ont profité de nos erreurs, en communauté comme à l’hôpital, chez l’homme comme chez l’animal, et menacent tous les continents, voyageant comme nous par avion.
Dans le même temps, les efforts de recherche ont fortement diminué et peu de progrès majeurs sont attendus. Certaines infections bactériennes graves ne peuvent désormais plus être traitées avec la panoplie de molécules disponibles.Pour faire face à cette épidémie silencieuse, véritable tsunami prêt à ramener nos sociétés aux années 1930, à une ère sans antibiotique, l’urgence est désormais à la prise de conscience, à des changements importants de comportements et à une reprise de l’innovation et de la recherche.



 (1)
(1)
La théorie du genre, dans sa forme la plus aboutie, nie la naturalité du sexe pour n’y voir qu’une construction purement culturelle. Elle considère que le modèle sexuel actuel -homme, femme- n’a d’autre fonction que d’assurer le primat de l’hétérosexualité et du masculin, en réprimant les modèles divergents.
Elle en appelle, dès lors -et logiquement- à éliminer toute référence au masculin et au féminin, et à porter le fer jusqu’au cœur de la loi, car ces références, explique-t-elle, ne sont que le paravent de "relations de pouvoir" illégitimes et oppressives.
La plupart des Français n'ont découvert l’existence de cette étonnante théorie qu’à l’occasion du débat sur le mariage homosexuel. Soit un an après l’adoption, au Conseil de l’Europe, de la Convention d’Istanbul contre les "violences de genre", qui consacrait la version la plus radicale de cette théorie.
Comment une prise de pouvoir aussi massive a-t-elle pu se réaliser de manière subreptice ? Quel est l’empire réel du "genre" sur le droit, en France et en Europe ? Quels sont les fondements et les objectifs ultimes de l’idéologie du genre ?
Telles sont les questions sur lesquelles Drieu Godefridi est venu nous entretenir.


 (0)
(0)
Rappeler rapidement et avec précision les bases nécessaires pour comprendre les différents usages et enjeux liés à l'utilisation des OGM, nous décrire la réalité de ce qui se trame au sein des laboratoires actifs dans la manipulation du vivant, ce sont les tâches auxquelles s'est assigné Christian Vélot.
OGM et recherche fondamentale, OGM et médecine, OGM dans l'agro-alimentaire : autant de catégories clairement différenciées afin d'éviter certains amalgames récurrents.
Les problématiques diffèrent grandement dans chacun des cas, notamment les risques sanitaires et environnementaux.
Une vulgarisation nécessaire.


 (0)
(0)
Quel est aujourd'hui l'état de nos terroirs ? Quel est l'état des sols de nos régions après quelques décennies de traitements aux engrais et aux pesticides chimiques ?
Le constat est accablant : la subtile interaction entre roche-mère, bactéries et mycorhizes est perturbée, quand elle n’est pas détruite.
Il est grand temps d'agir !
Emission "Terre à terre".


 (0)
(0)
Logicien renommé, inventeur de l'ordinateur, déchiffreur du code de la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing, élève réfractaire à la culture classique pendant ses études secondaires, se découvre une passion pour les sciences en étudiant la nature qui l'entoure : la croissance des plantes, la chimie du soda...
Finalement, il se révèle un mathématicien de génie, invente la fameuse machine de Turing et participe à la construction des premiers ordinateurs britanniques avant de proposer un modèle pour la croissance des formes biologiques.
Itinéraire d'un homme qui a tout pour lui... sauf d'être homosexuel dans une Angleterre très conservatrice.


 (0)
(0)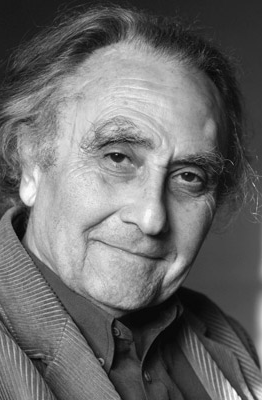
Les nouvelles représentations du vivant et l’explosion des biotechnologies ont créé des problèmes éthiques radicalement nouveaux sur la légitimité de leurs applications.
Mais il existe en outre d’autres enjeux : ceux liés aux interactions difficiles bien qu’indispensables entre les trois pouvoirs de la parole : la scientifique, la politique et la médiatique.


 (0)
(0)
Francis Wolff témoigne ici de sa pensée sur l'évolution de la conception de l'homme dans l'histoire de la philosophie.
On y retrouve quatre conceptions de la nature humaine : d'Aristote avec "l'animal rationnel" jusqu'à la figure actuelle de l' "homme des neurosciences, des sciences cognitives et de la biologie de l'évolution", en passant par la figure de "la substance pensante unie à un corps" de Descartes et l'homme des sciences humaines, de la sociologie et de la psychanalyse au XXème siècle.
La conférence s'est tenue au couvent des Dominicains de Lille.


 (0)
(0)
Jusqu’en 1959, on appelait la trisomie mongolisme ou syndrome de Down. Les allégations souvent fantasques relatives aux différences physiques des enfants atteints, prirent fin grâce à la découverte par le médecin français Jérôme Lejeune de la présence d’un chromosome supplémentaire sur la 21e paire.
Retour sur l’histoire de cette découverte ainsi que sur les questions éthiques actuellement posées, en compagnie de Jean-Marie Le Méné, président de la fondation Jérôme Lejeune.