

 (0)
(0)
Le Transhumanisme est le principal non-dit du débat politique contemporain, il est pourtant l'un des enjeux essentiel de l'humanité, en ce qu'il pose la question même de son devenir.
Négation ou sublimation de l'humain ? Agent de justice ou outil des puissants ? Destin implacable ou projet politique ? Utopie ou dystopie ?
Pour répondre à ces questions dans le cadre d'un débat qui se veut contradictoire et constructif, nous avons :
- M. Marc Roux, président de l'Association Française Transhumaniste, qui se définit comme "transhumaniste de gauche" et "techno-progressiste".
- M. Miguel Benasayag, philosophe et universitaire libertaire franco-argentin, instigateur du mouvement Malgré Tout, critique du projet transhumaniste et auteur remarqué du livre Cerveau augmenté, homme diminué (2016).
Un organisé par association l'association Contre-Courant de Sciences-Po Paris.


 (0)
(0)
Venue d’Amérique, comme l’idéologie de la décision des années 70 et celle de la communication des années 80, l’utopie de la "santé parfaite", qui les relaie, est l’avatar le plus achevé du technoscientisme.
Dans cette intervention, Lucien Sfez décrit ces grandes aventures qui pourraient avoir une influence capitale sur nos sociétés : le gigantesque projet de séquençage du génome humain, l’expérience Biosphère II et les tentatives de créer sur ordinateur des êtres artificiels (artificial life). Trois cheminements vers la surhumanité, vers un Adam d’avant la chute, en quelque sorte vers l’immortalité...
Mais les aspirations au retour à l’origine, à l’indistinction des sexes, à la totale propreté, à une hygiène alimentaire absolue et à une sécurité sans faille, toutes fruits de l'utopie, ne sont-elles pas autant de manières de camoufler les divisions sociales et de les perpétuer ?


 (0)
(0)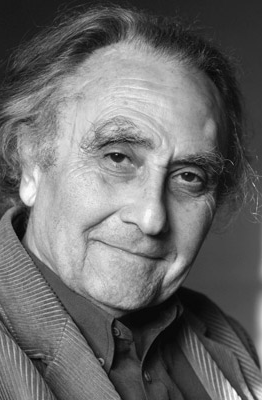
C'est au cours de ses premiers travaux de recherche portant sur le vieillissement et son mécanisme de désorganisation qu'Henri Atlan s’intéresse à la notion d’organisation et aux facteurs d’organisation et de développement. Il développe alors une espèce de formalisme qui permet de comprendre comment se fait la création de diversité, de complexité à partir d'événements aléatoires, de perturbation sur des systèmes organisés, sous certaines conditions. Là où l'on pense alors que des perturbations aléatoires ne peuvent avoir qu’un effet négatif, de destruction de toute l'organisation, il est possible de montrer que dans certaines conditions, les facteurs de perturbation ou "bruit" peuvent favoriser l'émergence de nouvelles formes d'organisations, de formes d'auto-organisation.
Dès que le code génétique est déchiffré, ces considérations n'ont plus d'importance dans la communauté des biologistes. S'impose alors la métaphore du "programme génétique", c’est-à-dire le parallèle, par raisonnement analogique, entre la structure de l'ADN et un programme d'ordinateur.
Or, Henri Atlan affirme que les organismes vivants ne peuvent pas être réduits à la structure des gènes et remet en cause le tout-génétique. Tout n'est pas écrit dans les gènes sans pour autant dire qu'il n’y a pas de déterminisme biologique. Il existe d'autres déterminismes - mécaniques, physico-chimiques et biologiques - qui ne sont pas génétiques. Pour comprendre le fonctionnement des gènes, il faut s'intéresser à leur organisation, au sens d'une organisation complexe. D'où un renouveau de l'interrogation de recherche de techniques de modélisation pour essayer de maîtriser d'une certaine façon la bio-complexité.
Henri Atlan mentionne également la place de la philosophie dans sa réflexion scientifique, particulièrement celle de Spinoza et l'importance du spinozisme actualisé et parle des activités du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.


 (0)
(0)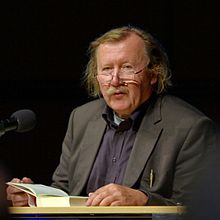
Il y a environ quinze ans, le monde apprenait l’achèvement du séquençage complet de l’ADN d’un génome humain. Des débats enflammés, parfois à caractère religieux, se sont alors répandus dans les médias autour des conséquences possibles de cette avancée scientifique et notamment sur les avantages et les risques liés aux modifications génétiques, en particulier chez l’être humain. La situation s’est aujourd’hui apaisée. Le débat éthique a porté ses fruits et les connaissances techniques et scientifiques se sont propagées.
Dans ce contexte, le philosophe Peter Sloterdijk voit en la recherche génomique, liée à l’humain, des chemins prometteurs menant à l’optimisation des conditions de la vie humaine. Pour lui, l’esprit utopique trouve aujourd’hui dans la recherche scientifique un nouveau lieu d’expression.
Une conférence qui se tient durant le 17e Colloque Wright.


 (0)
(0)
Alain Ehrenberg se pose la question des frontières entre le biologique et le social, entre l'individuel et le collectif, entre l'homme et l'animal, entre le vivant et le non vivant.
Car les frontières que nous établissons ne sont-elles pas le reflet de notre incapacité ou de notre difficulté à penser la complexité du vivant ?
En tant que sociologue qui s'est interrogé sur les relations entre l'individu et la société, entre le biologique et le social, Alain Ehrenberg se propose d'envisager le cerveau comme un fait scientifique mais aussi comme un fait social.


 (0)
(0)
Le matérialisme que Patrick Tort interroge et construit n’est pas une "philosophie", mais la condition de possibilité et l’outil de la connaissance objective. Historiquement, il se confond avec l’élaboration de la science moderne s’affranchissant graduellement des contrats de parole qui l’asservissaient à la métaphysique et à la théologie.
Comment, d’une part, cette émancipation s’est-elle effectuée en des temps où une croyance instituée imposait a priori la limite de l’Inconnaissable ? Comment, d’autre part, une métaphysique résiduelle impose-t-elle toujours aux artisans de la connaissance objective, sans qu’ils s’en doutent, des cadres, des frontières, des démarches et des représentations ?
Revenant sur une part essentielle de son œuvre, Patrick Tort invite ici à une véritable réforme logique de l’initiative de connaissance, et, simultanément, à instruire la méthode capable d’éclairer les mécanismes qui la favorisent ou qui la combattent dans l’univers infini des discours.


 (0)
(0)
Le mouvement féministe a produit bien plus qu'une dynamique d'égalisation des conditions féminine et masculine. Il a contribué, montre Camille Froidevaux-Metterie, à réorganiser en profondeur notre monde commun, à la faveur d'un processus toujours en cours qui voit les rôles familiaux et les fonctions sociales se désexualiser. Par-delà les obstacles qui empêchent de conclure à une rigoureuse égalité des sexes, il faut ainsi repérer que nous sommes en train de vivre une véritable mutation à l'échelle de l'histoire humaine. Plus d'attributions sexuées ni de partage hiérarchisée des tâches : dans nos sociétés occidentales, la convergence des genres est en marche.
La similitude de destin des hommes et des femmes ne renvoie pourtant à aucune homogénéisation. Dans un monde devenu mixte de part en part, les individus se trouvent plus que jamais requis de se définir en tant qu'homme ou en tant que femme. Or ils ne peuvent le faire sans prendre en considération la sexuation des corps. S'évertuer à la nier, comme le fait un certain féminisme, c'est heurter de plein fouet cette donnée nouvelle qui veut que la maîtrise de sa singularité sexuée soit la marque même de la subjectivité.
Camille Froidevaux-Metterie entreprend ainsi de réévaluer la corporéité féminine pour en faire le vecteur d'une expérience inédite englobant l'impératif universaliste des droits individuels et l'irréductible incarnation de toute existence. Le sujet féminin contemporain se révèle alors être le modèle d'une nouvelle condition humaine.
Une intervention dans le cadre du séminaire ANR de philosophie politique du Centre International de Philosophie Politique Appliquée, organisé par Alain Renaut et Jean-Cassien Billier.


 (0)
(0)
Des millions d'années avant l'apparition de l'homme, la vie avait déjà inventé la roue, le moteur atomique, le sonar, le vol stationnaire, la capture de l'énergie solaire, l'éclairage électrique, le GPS et des myriades de techniques qui nous dépassent encore complètement : cicatrisation, reproduction, congélation suivie de réanimation, et des cerveaux dont chacun des milliards de neurones est un univers informatique. Pour le comprendre, il a fallu attendre que nos propres technologies atteignent les profondeurs moléculaires du vivant, nous révélant que les inventions de la nature étaient infiniment plus complexes que les nôtres.
"Le service Recherche et Développement de la nature a 3,8 milliards d'années d'avance sur ceux de nos entreprises", aime dire Janine Benyus, la naturaliste américaine qui a inventé le concept de biomimétisme. "Il s'agit de nous en inspirer pour pousser plus loin nos propres inventions, mais surtout pour corriger le tir de ces dernières, qui nous ont conduits dans les impasses écologiques que l on sait."
Il existe trois niveaux de biomimétisme. Le premier consiste à imiter les formes de la nature. Le second, de plus en plus prisé des industriels, repose sur l'imitation des matériaux et des processus naturels. La vraie révolution repose cependant sur le troisième niveau, qui consiste à imiter les stratégies du vivant, sa philosophie. Ce troisième niveau a des implications fascinantes. Ainsi, contrairement à l'image que nous nous faisons de la "loi de la jungle", la nature ne pratique la compétition que dans 10% des rapports entre organismes. Les 90% restants sont fondés sur la coexistence, le mutualisme, la coopération, le commensalisme, le parasitisme et la symbiose. À imiter absolument !