

 (0)
(0)
Sur le plan historiographique, l’usage est de résumer l’affrontement politique au XIXème siècle comme le combat engageant une Droite libérale et une Gauche radicale présumément socialiste ; les récits et les mémoires oublient bien souvent ces catholiques, qui au nom d’une morale et d’une éthique propres, incarnèrent la lutte contre la modernité.
Le Catholicisme social, forme conjoncturelle de la Doctrine sociale de l’Eglise, se constitua en un mouvement autonome, véritable troisième voie face aux impasses libérales et socialistes."Nous voulons une solution de la question sociale, voilà tout, et cette solution, nous la demandons à la tradition chrétienne" déclarait l’une des figures de proue du mouvement, Albert de Mun.
De ce courant protéiforme et éminemment social Léo Imbert tente de saisir l’essence ; celle-ci fit sa force et impacta son temps puis se dilua dans les dédales des compromissions.


 (0)
(0)
L'ambition de cette conférence est de fournir à la philosophie de Péguy l' "appareil" capable de manifester le plus fidèlement possible le "profond ordre intérieur" qui tient ensemble la multitude de textes qui a jailli génialement de sa plume.
Loin de pointer les contradiction d'un homme, il s'agit alors de suivre la continuité et la cohérence d'un chemin, par-delà toutes les ruptures apparentes, qui se déroule selon un drame chrétien : l'état d'innocence, d'abord, la pureté de son combat socialiste et une jeunesse saisie par l'événement de l'Affaire Dreyfus et tenue par la venue imminente de la cité harmonieuse ; la chute, ensuite, avec l'histoire de la décomposition du dreyfusisme et l'enfer du monde moderne ; le salut, enfin, avec le retour de la foi catholique et les nouvelles ressources que lui prodigue la vertu d'espérance.


 (0)
(0)
L’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers. L’intérêt du moment n’est pas celui de l’avenir.
Comment déterminer, aujourd’hui, dans le contexte actuel mais pour les générations à venir, ce qui est bien, juste, bon, durable, efficace, légitime ? Et comment s’assurer que la société mettra en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre le but fixé ? Comment surtout ne pas tendre vers l’utopie mais s’inscrire dans la réalité, forcément mobile, de la nature, des êtres, des gens, des communautés, des peuples, des nations ?
Une table ronde modérée par Stéphane Blanchonnet.


 (0)
(0)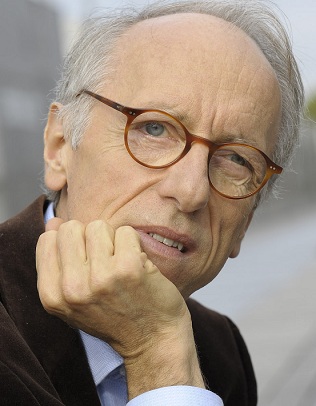
Le nom d’Henri Saint-Simon (1760-1825) est plus célèbre que son œuvre qui a subi de multiples lectures déformantes, à commencer par l’école saint-simonienne. Ayant exercé une grande influence au XIXe siècle, son œuvre est à la source des grandes idéologies contemporaines.
Quatre grands courants de pensée sont issus directement de la pensée de Saint-Simon :
- le positivisme d’Auguste Comte, son disciple et collaborateur ;
- des socialismes dont celui de Pierre Leroux, la pensée anarchiste de Proudhon, et surtout le marxisme ;
- un courant de la sociologie inaugurée par Emile Durkheim et Marcel Mauss ;
- l’école saint-simonienne, elle-même multiforme.
Saint-Simon fait émerger la problématique sociologique, notamment le concept de société et de changement social. Il conçoit même un nouveau système social, puis cherche une méthode pour le réaliser. Une préoccupation permanente traverse sa réflexion : "faire une combinaison ayant pour objet d’opérer la transition de l’ancien au nouveau régime social". Après la Révolution française qu’il considère comme inachevée, Saint-Simon veut changer l’ordre des choses au bénéfice de la "classe la plus pauvre", ouvrant la voie au socialisme.




 (1)
(1)
Ces émissions constituent une très bonne introduction aux grandes problèmatiques politiques. Politique est ici à prendre au sens où l'entendaient les anciencs, soit l'art d'accorder l'individu (l'un) et la communauté (le multiple).
L'approche thèmatique nous montre comment l'aspect politique des problèmes auxquels nous sommes confrontés est aujourd'hui réduit à la portion congrue. Mais pouvons-nous espérer résoudre les grandes questions de notre temps sans agir politiquement ?


 (0)
(0)
D’aucuns se souviennent du film Lawrence d’Arabie de David Lean et de ce qui s’y joue : la réalisation du nationalisme arabe ou "panarabisme". Ce vieux rêve fédéraliste prit naissance au XVIIIe siècle, en réaction à la tutelle ottomane ; il mena à la "grande révolte arabe" de 1916, fut trahi par les accords Sykes-Picot, puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il prit une ampleur considérable avec l’action du parti Baas et la plume de Michel Aflak – ce "Maurras arabe", selon Charles Saint-Prot. L’âme arabe, ce n’est pas l’islamisme ! Au contraire, l’islamisme est né, du moins s’est développé, grâce à la chute du dernier régime baasiste qui fut celui de Saddam Hussein.
À l’heure où les Occidentaux ont pris, plus ou moins directement, plus ou moins consciemment, le parti de l’internationale djihadiste contre celui des nations arabes, le Cercle Henri Lagrange propose la vidéo d’un entretien passionnant sur l’histoire et l’actualité du panarabisme.


 (0)
(0)
La plupart des commentateurs de l'époque s'accordent à voir dans le capitalisme libéral mondialisé un système en faillite. Chute de la croissance, chômage de masse, dettes publiques au plus haut, effondrement des acquis sociaux… Les discours déclinistes d'hier sont devenus le triste constat de la réalité des temps présents.
Pourtant, si tous les spécialistes déplorent à l'unisson l'actuel échec du libéralisme économique, beaucoup de nos contemporains demeurent encore peu éclairés sur le rôle du libéralisme culturel dans l'essor et le développement des sociétés capitalistes. La mutilation du lien social, la culture du narcissisme, le règne médiatique du clash ou encore le triomphe de l'individu-roi : autant de phénomènes qui, sans même que l'on s'en aperçoive, soutiennent et dynamisent au quotidien l'irrésistible déploiement de la logique libérale dans nos états occidentaux modernes.
Ancien militant d'extrême gauche, Charles Robin revient sur son parcours pour montrer comment le libéralisme culturel célébré par la gauche, de la Révolution française à Mai 68, de Montesquieu et Voltaire à Skyrock et aux Femen, a participé à faire consentir les peuples à la tyrannie du capital et à l'aliénation de leurs consciences au pouvoir de la marchandise. En philosophe, mais dans un langage accessible au plus grand nombre, il nous encourage à nous affranchir des étiquettes.


 (0)
(0)
Il s'agit d'explorer, dans cette conférence, la signification et les conséquences de l’idée de "common decency" empruntée à Orwell. La réactivation de cette idée pourrait nous offrir une nouvelle dynamique de transformation sociale, radicalement différente des tendances traditionnelles du socialisme et du communisme révolutionnaires.
L'idée n'est pas de faire ici l’exégèse du socialisme orwellien, mais, en, partant d’Orwell, d’essayer de tracer quelques lignes pour un autre socialisme, un socialisme des hommes ordinaires et non de proposer le retour à une utopie définitivement enterrée.