

 (0)
(0)

 (0)
(0)
Depuis une trentaine d'années, les grands projets technologiques suscitent des critiques croissantes et de nombreux conflits. Le rapport des sociétés au "progrès" et aux techniques semble basculer, alors que la collusion entre capitalisme et science met chaque jour un peu plus en péril l'équilibre écologique de notre planète.
Pourtant, les critiques des trajectoires technologiques n'ont rien d'inédites, elles n'ont cessé d'accompagner et de modeler les sociétés industrielles.
Du XVIIIe siècle à nos jours, le langage pour dire le refus des techniques a évolué en permanence, les raisons de craindre la prolifération des artefacts se sont modifiées sans cesse au fur et à mesure des transformations des régimes de production et des milieux techniques. Il ne s'agit ni de dresser une galerie de portraits des prophètes incompris, ni de rechercher dans le passé des justifications aux inquiétudes d'aujourd'hui. L'enjeu est de montrer l'historicité des attitudes de refus face à la technique, par-delà les répressions et les disqualifications qui n'ont cessé de les accompagner, jusqu'à les rendre invisibles.


 (0)
(0)
Les techniques promettent abondance et bonheur ; elles définissent la condition humaine d’aujourd’hui. Pourquoi les contester, et à quoi bon ? Les discours technocritiques ne masquent-ils pas des peurs irrationnelles, un conservatisme suranné, voire un propos réactionnaire ?
Pourtant, depuis que les sociétés humaines sont entrées dans la spirale de l’industrialisation, des individus et des groupes très divers ont dénoncé les techniques de leur temps et agi pour en enrayer les effets.
L’introduction de machines censées alléger le travail, les macrosystèmes techniques censés émanciper des contraintes de la nature, la multitude des produits technoscientifiques censés apporter confort et bien-être, ont souvent été contestés et passés au crible de la critique.
Contre l’immense condescendance de la postérité, il s’agira d’explorer ces discours et luttes foisonnantes et multiformes pour mieux comprendre comment s’est imposé le grand récit chargé de donner sens à la multitude des objets et artefacts qui saturent nos existences.


 (0)
(0)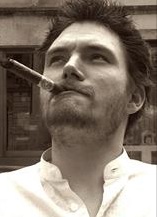
Jean Bricmont, professeur de physique à l'Université de Louvain, auteur de plusieurs livres et connu pour sa défense inconditionnelle de la liberté d'expression, débat avec David L'Epée, collaborateur des revues Eléments, Krisis et Rébellion.
Tous deux rationalistes et incroyants, ils évoquent la question du renouveau spirituel, notamment dans les mouvements d'opposition au système, et des difficultés de faire passer un message fondé sur la raison à une époque de retour du religieux.


 (0)
(0)

 (0)
(0)
Cette question est aussi étrange que fondamentale, et d'autant plus difficile lorsque l'exigence de penser le conservatisme est posée dans une époque qui veut nous convaincre des vertus de la marche forcée vers la modernité.
Il est vrai que le conservatisme, dans notre monde, est davantage une indignation qu'une accusation. Mais cette question se pose évidemment de manière particulière en France, qui n'a pas, à proprement parler, de tradition conservatrice, ou du moins, qui ne l'assume pas comme telle et surtout, où à peu près personne, ne revendique une telle étiquette.
Alors : que veut dire être conservateur ?


 (0)
(0)
L'adoption prochaine d'une nouvelle motion par le Parti Socialiste sera-t-elle le Bade-Wurtemberg des socialistes français ?
Un panel d'invités aux opinions fort différentes débattent de l'histoire et de l'avenir de ce parti qui aura en grande partie façonné la vie politique française au XXe siècle.
Émission du Libre Journal d'Henry de Lesquen.


 (0)
(0)
La France est aujourd'hui gouverné par une équipe sortant du Parti Socialiste. Mais de quel héritage politique parlons-nous ?
En se penchant sur l'histoire du mouvement socialiste (et en particulier sur l'oeuvre de Jules Guesde Essai de catéchisme socialiste), David Mascré s'emploie à comprendre quelles sont les grandes idées qui mènent l'idéologie socialiste.