

 (0)
(0)
Qui aujourd'hui peut prétendre connaître le repos ? Question rhétorique, bien sûr, tant nous sommes tous happés par les tourbillons de la vie postmoderne ! Les moments de remontée à la surface et de respiration se font en effet de plus en plus rares, et force est de constater que nous devons bien souvent demeurer en apnée prolongée. Au risque de notre santé et, encore plus fondamentalement, de notre humanité.
Les travaux récents de Baptiste Rappin se proposent d'appréhender la condition de l'homme contemporain, caractérisée par le changement perpétuel et le mouvement sans fin, de façon originale, en replaçant au cœur de la réflexion le management autour duquel s'élabore un véritable système philosophique dans toutes ses dimensions : épistémologique, politique, métaphysique et même théologique.
Et ce notamment en montrant par quels chemins l'exception a pu s'imposer, à notre époque, comme la norme de gouvernement de nos sociétés. De ce point de vue, la crise n'apparaît plus comme un dysfonctionnement qu'il s’agirait d'éliminer à coups de mesures techniques, mais bien comme le fond ontologique à partir duquel se déploie notre rapport aux temps présents.


 (0)
(0)
Le management scientifique relève de l'utopie en ce qu'il est sans site, sans topos, car il est plus porté par une dynamique temporelle, celle de la synchronisation générale des activités humaines, que désireux de s'enraciner dans un lieu singulier. On peut également soutenir une thèse semblable en ce qui concerne le rapport social qu'instaure le capitalisme au sein duquel l'impératif abstrait de valorisation ne prend sens qu'avec les quanta de temps de travail social dépensés lors d'une activité productive.
C'est donc sous l'angle de la temporalité que peuvent être conjointement saisies les deux grandes révolutions modernes que sont le capitalisme et le management.
Une intervention dans le cadre des "leçons de la Sphère", dispensées par Carlos Pereira.


 (0)
(0)
Plusieurs bons esprits ont commencé de considérer les effets que le coronavirus et la manière dont l'affronte l'humanité pourraient avoir sur les rythmes de nos vies. Nul doute que le confinement ait ralenti, pour un temps au moins, l'allure de nos existences, en dépit des promptitudes qu'autorisent les nouvelles technologies.
L'écologie met en garde contre l'exaspération des tourismes de masse. L'aviation et ses obsessions supersoniques subissent un déclin imprévu. La marche à pied et la bicyclette trouvent une popularité tout à coup accrue. L'idée d’une accélération de l'Histoire, naguère admise comme une évidence, a du plomb dans l'aile.
Le moment est donc venu de s'interroger sur la confrontation de la lenteur, dans le long terme, avec la vitesse. Une lenteur dénoncée, dénigrée, combattue, depuis le XIXe siècle en particulier, comme une résistance à toutes les forces de l'industrie conquérante. Mais une lenteur qui a souvent porté haut les valeurs de la liberté, en protestant contre tous les censeurs qui voulaient l'assimiler à la paresse...
Émission "Concordance des temps", animée par Jean-Noël Jeanneney.


 (0)
(0)
Au fil des siècles, de nombreux courants de pensée ont façonné notre conception du monde et notre manière d'appréhender l'existence : Qu'est-ce que la vérité ? Comment peut-on vivre heureux ? Dieu existe-t-il ? Quel est le sens de notre vie ?
Bien loin du jargon des spécialistes, le professeur de philosophie Charles Robin nous rend accessible les œuvres des plus grands philosophes afin d'en faciliter la compréhension et, pourquoi pas, de nous faire changer le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur le monde.
Une initiation sérieuse à une discipline souvent difficile d'accès, dans un langage clair et une atmosphère détendue.


 (0)
(0)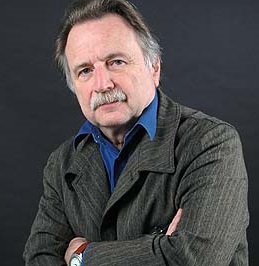
Diminution des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution des sols, de l'eau, de l'air, déforestation rapide, sans oublier, bien sûr, le changement climatique d'origine anthropique. En ces domaines, tous les indicateurs sont alarmants et toutes les projections sont inquiétantes.
Aujourd'hui, qu'allons nous faire de l'angoisse écologique ? Que se passe-t-il donc ? Qu'est ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, se construit ? Qu'est ce qui s'y détruit ? Nous l'ignorons pour une grande part, mais c'est paradoxalement parce que nous avons compris quelque chose. Nous avons compris que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous.
Dès lors, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire ? Nous sommes désormais conscients que nous grignotons de plus en plus avidement le fruit terrestre de taille finie qui nous porte, mais nous ne savons pas comment enrayer cette mauvaise tendance. Alors nous pressentons que cet avenir même que nous sommes en train d'anticiper par nos actions aussi bien que par nos inactions, pourrait se révéler radicalement autre. Et au fond de nous mêmes, nous le craignons.
Régis Debray, écrivain et philosophe, nous éclaire sur le concept d'angoisse écologique, à l'occasion de la sortie de son ouvrage Le siècle vert. Un changement de civilisation (Gallimard, 2020).
Émission "La Conversation scientifique", animée par Etienne Klein.


 (0)
(0)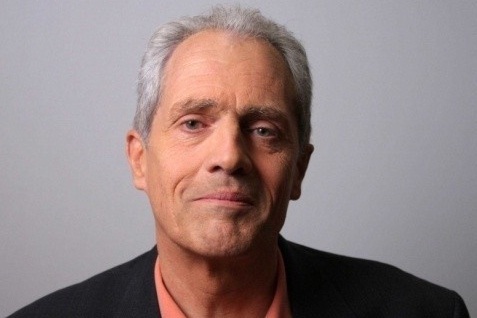
Si sa définition traditionnelle marque en quoi le temps est une présence indéfinie, homogène et invariable au sein de laquelle se déploient êtres, choses et événements se succédant de façon ininterrompue, l'expérience du temps dévoile aussi cette présence constante comme tantôt alourdie par des lenteurs, tantôt avivée par des accélérations.
Comment penser à la fois ces deux données irréconciliables du temps : son écoulement continu et les singularités de ses expériences vécues, qui en font varier la durée ? Sa constance et sa persévérance irréversibles et les moments, les instants, les scansions de ses expériences, parfois accusant des atermoiements, parfois filant telles des précipitations ?
Il nous faudra aussi chercher à savoir en quoi ce qu'il convient de nommer l'accélération du temps entraîne des changements sociaux considérables, des transmutations politiques, des modifications insoupçonnées de la sphère intersubjective. En effet, l'actualité est traversée par une accélération du temps où de nouvelles possibilités d’existence ne cessent de s'ouvrir à un rythme effréné.
Fort paradoxalement, nous ressentons le sentiment de ne plus posséder le temps nécessaire pour entreprendre quoi que ce soit. Et ainsi, les individus tendent à privilégier des activités de faible satisfaction, de court terme, par rapport à d'autres plus valorisantes, mais toujours différées.
Or la technique n’est pas seule responsable de ce phénomène, la cause est aussi idéologique et correspond au "projet de la modernité" : le désir d'autonomie. Nous ne voulons être liés à rien et être toujours disponibles de sorte à ne jamais manquer quoi que ce soit.
Quelles sont les sources et quelles seront les conséquences de cette situation temporelle affectant l'ensemble de nos expériences, personnelles et sociales ?


 (0)
(0)
L'accélération du progrès technologique est peut-être ce qui caractérise le mieux notre époque. Nous avons développé des outils qui nous donnent un pouvoir immense et d'une sophistication encore inimaginable il y a quelques décennies.
La révolution numérique en particulier a eu pour conséquence une accélération du rythme de l'innovation, permettant notamment à l'information de circuler tout le temps et partout, au point que nous sommes tous plus ou moins dépassés par la profondeur et vitesse de changement de notre environnement.
Olivier Ezratty est un veilleur technologique qui passe son temps à tenter de comprendre ce que le développement et la diffusion des technologies numériques impliquent pour la société, les entreprises et les individus. Il revient ici sur l'histoire récente de la tech, de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et de ce qu'il faut en retenir pour mieux appréhender la complexité du monde actuel et imaginer ce qui arrive.
Un entretien mené par Julien Devaureix.


 (0)
(0)
Quelle est l'origine de l'oeuvre d'art ? Et pourquoi ajouter des oeuvres d'art à la pléthore de beauté, d'invention, d'humour qu'offre le monde tel qu'il est ? La réflexion de George Steiner renouvelle la philosophie des valeurs en interrogeant les arts, c'est-à-dire ce qui met les valeurs à l'épreuve de la manière la plus immédiate.
Sous le double signe de la pensée pure et de l'approche critique sont interrogés les théories philosophiques de la création esthétique, de Platon et Aristote à Saint-Augustin, Nietzsche et Heidegger et les témoignages des artistes eux-mêmes.