

 (0)
(0)
Alors que l'Europe est soumise à un afflux de migrants sans précédent, l'Eglise catholique semble imposer une vision de "l'accueil de l'autre" qui favoriserait ce que le Pape François a qualifié d' "invasion".
Laurent Dandrieu interroge : existe-t-il une autre voie qui permette de réconcilier les impératifs de la charité et de la défense de la civilisation européenne ?
Une conférence organisée par les Associations Familiales Catholiques.


 (0)
(0)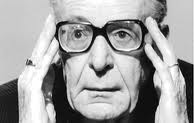
Henri Guillemin dérange. Avec lui, l'histoire politique et littéraire prend, sous un éclairage nouveau et passionné, un visage jusque là inconnu. Son approche iconoclaste suscite toujours autant de passions. Haï par ses détracteurs, adulé par ses inconditionnels, il dérange les habitudes coincées des "spécialistes", bouscule les idées reçues et enthousiasme les rebelles...
Ses entretiens nous font découvrir un peu plus l'homme authentique qui se cache derrière une oeuvre tout entière dévouée à rétablir la vérité.
Une émission animée par Françoise Malettra, avec les interventions de Claude Mauriac, Henri Mitterand, Georges Piroué, Jean Ziegler, Claire Etcherelli et Louis Casamayor.


 (0)
(0)
Dans son dernier livre L'imposture du vivre ensemble, Paul-François Paoli nous présente un panorama -non exhaustif- de la vie intellectuelle française et de ses enjeux idéologiques à travers un certain nombre d'éléments de langage et de noms propres couramment utilisés par les hommes politiques, les journalistes et les citoyens.
L'occasion de revenir avec lui sur l'état de santé intellectuelle du débat d'idées en France...
Émission du "Libre Journal de la jeunesse", animé par Hugues Sérapion.


 (0)
(0)
Laurent James, physicien et écrivain français catholique, nous démontre dans cette conférence les liens métaphysiques unissant les peuples du continent européen et explique le rôle plus qu’important de la Russie dans le salut de l’Europe.
En effet, on peut lire les mots suivants dans une lettre de Dostoïevski à Nikolaï Strakhov en 1869 : "Le fond de la destinée russe consiste à révéler au monde un Christ russe, inconnu à l’univers, et dont le principe est contenu dans notre orthodoxie. A mon avis, c’est là que se trouvent les éléments de la future puissance civilisatrice, de la résurrection par nous de l’Europe".
De Dostoïevski à Jean Parvulesco, en passant par Paul Morand et Jean Romanidès, nous voyons les rapports que peuvent entretenir cette vision de Moscou comme Troisième Rome avec la perspective eschatologique de l’ère du Fils glorieux succédant à celle du Fils crucifié.


 (0)
(0)
Le concept de "judéo-christianisme", mis en avant par le concile Vatican II, est si souvent évoqué pour qualifier notre civilisation, devenu si banal, qu’on oublie souvent de s’y arrêter. Que veut-il dire ? Quelle est sa réalité ? En a-t-il même une ?
Alors qu’avec Constantin Ier le christianisme s’imposait au monde gréco-romain, le talmudisme, qui prétend éclairer la Torah par une compilation de Lois orales d’origine rabbinique, devenait la nouvelle acception d’un judaïsme définitivement dégagé du culte sacerdotal judéen. Judaïsme post-chrétien traitant de règles et de prescriptions, dans lequel le mot "foi" est singulièrement absent. Dès lors, que peut-on dire de cette prétendue filiation qui lierait le christianisme au judaïsme ?
Pour répondre à cette question, Claude Timmerman est retourné aux temps de l’écriture des textes bibliques. Il a puisé au cœur de l’archéologie, relevant les différents anachronismes, les acrobaties logiques et linguistiques au service des mythes historiques sur lesquels s’appuie la création de l’État sioniste et la perpétuation de sa puissance.
Une mise au point indispensable.


 (0)
(0)
De l’avis général, la révocation de l'édit de Nantes est l'une des erreurs les plus graves commise par Louis XIV. Tensions religieuses, incidents, émigration massive, hostilité internationale… les conséquences négatives sont légion.
Pourquoi le roi a-t-il pris cette décision si contestée ? A-t-il été influencé ? Était-ce une folie ? Ou au contraire un acte tout à fait logique et cohérent ?
C’est à toutes ces questions que l'historien Jean de Viguerie entend répondre de manière honnête et en sortant pour des opinions convenus.


 (0)
(0)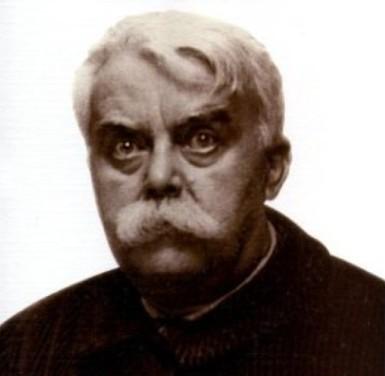
"Le grand artiste [Léon Bloy] vient nous montrer ce qui se cache depuis la perte du Paradis terrestre dans les abîmes du cœur des hommes ; ces trésors séculiers résident aussi bien chez tous que chez lui, mais il a, pour les faire remonter à la surface, une mirifique poulie et les autres n'en disposent pas. Un Shakespeare, un Baudelaire, un Dostoïevski, un Wagner ou un Bloy, qui découvrent des étoiles imprévues dans le ciel renversé des âmes, n'ont pas plus de constellations en eux, sans doute, que ce vulgaire piéton qui traverse la rue. Mais ils ont, pour les décrocher, des baguettes infinies."
Une série de cinq émissions, coordonnées par Stanislas Fumet, pour commémorer les cinquante ans de la disparition du "mendiant ingrat".


 (0)
(0)
Les écrits du contre-révolutionnaire Joseph de Maistre sont souvent assez mal connus et donnent lieu à toutes sortes d'interprétations. Car la pensée maistrienne, finalement assez proche de la doctrine des théologiens de l'époque, est un molinisme affirmé et consolidé par un recours constant aux Pères et aux Docteurs de l'Église, mais aussi à Origène, dont l'œuvre est souvent sollicitée par les théologiens de la fin du XVIIIe siècle.
Marc Froidefont nous invite à nous pencher sur la vie et l'oeuvre de celui dont la théologie est parfois présentée -à tort- comme un catholicisme teinté d'illuminisme, voire hétérodoxe.