

 (0)
(0)
La France s'est longtemps définie comme la fille aînée de l'Église. Dans la République laïque, le catholicisme est resté majoritaire jusqu'à la fin des années 50. Conjointement une foi mais aussi une pratique, le catholicisme portait notamment la sanctification des fêtes, la messe dominicale, la confession annuelle et le respect des règles de jeûne.
En quelques décennies, la pratique s'est si spectaculairement évaporée que l'historien Guillaume Cuchet se demande si le catholicisme a encore de l'avenir en France !
L'hypothèse de sa disparition n'est donc plus aberrante mais plausible ; qu'est-il arrivé pour qu'une telle question se pose aujourd'hui ?
Émission "Répliques", animée par Alain Finkielkraut.


 (0)
(0)
C'est au travers des témoignages des historiens Mona Ozouf, Pierre Nora, Emmanuel Leroy-Ladurie et Pierre Rosanvallon, des avocats Georges Kiejman et Jean-Denis Bredin, du journaliste et résistant Gilles Martinet et aussi Daniel Bensaïd et Jean d'Ormesson, que se dessine le portrait de François Furet.
Enregistrée en partie à Sofia, en Bulgarie, l'émission retrace ses années d'appartenance au Parti Communiste, les raisons de sa rupture avec celui-ci et celles qui avaient guidées ensuite sa démarche intellectuelle et ses positions politiques. L'occasion également de découvrir l'intérêt tout particulier qu'il portait au Judaïsme et à Israël, et d'apprendre que l'enseignement l'ennuyait !
Une émission qui, au-delà de l'historien, révélait un homme très cher à ses amis, qui aimait la vie et qui aimait les femmes. Un intellectuel de premier plan qui, d'une mauvaise chute, devait mourir à 70 ans.


 (0)
(0)
Q'est-ce que Barrès représentait pour la jeunesse intellectuelle de son époque, notamment en tant que figure politique ? Comment son nationalisme et son nihilisme doivent-ils être analysés ?
Autant de questions abordées pas plusieurs auteurs confirmés (Albert Thibaudet, Henry de Montherlant, François Mauriac) et d'autres plus jeunes (Claude Roy, Jean-Louis Curtis, Michel de Saint Pierre).


 (0)
(0)

 (0)
(0)
Ce sont des histoires de voyages, de Tahiti à Hawaï, mais aussi dans la cité grecque antique ou au pied du mur de Berlin ; ce sont des rencontres avec des étudiants, devenus de grands penseurs, avec des historiens du passé, avec Hérodote, mais aussi avec Chronos et Kronos. C’est une histoire du temps, sans être une histoire du temps qui passe et de ce qui nous lie au temps. Avec François Hartog, mettons-nous au régime… au régime d'historicité !
Émission "Le Cours de l'histoire", animée par Xavier Mauduit.


 (0)
(0)
En 1988, alors que se profilait à l'horizon le Bicentenaire de le Révolution, Flammarion éditait un Dictionnaire critique de la Révolution Française dirigé par Mona Ozouf et François Furet. À l'occasion de sa parution les deux historiens étaient invités étant convié à commenter dans le même temps l'ouvrage qu'il publiait chez Hachette, La Révolution 1770-1880 - De Turgot à Jules Ferry.
Le débat, auquel participe également l'historien américain Eugen Weber, rappelle en quoi certains historiens s'étaient démarqués des analyses historiques qui avaient longtemps prévalu en France avant leurs travaux. Pour rappel, en 1978 avec son ouvrage Penser la Révolution française, (précédé en 1971 d'un article musclé, Le Catéchisme révolutionnaire) François Furet contestait radicalement l'historiographie jacobino-marxiste qui dominait alors les débats d'historiens à propos de la Révolution.
À quelques mois du Bicentenaire, cet échange annonce le début d'un temps nettement plus favorable aux thèses de François Furet qui déclarait alors : "La gauche marxiste et la droite contre-révolutionnaire sont d'accord sur un point : considérer la Révolution comme un bloc qu'il s'agit de magnifier ou de couvrir d'opprobre. Il est temps, après deux siècles de guerre civile idéologique, d'affirmer que la Révolution française est terminée et de la considérer enfin comme un objet de science".
Émission "Les lundis de l’histoire", animée par Philippe Levillain.


 (0)
(0)
Dans cet entretien réalisé en mai 1975, Edgar P. Jacobs, vraie légende de la "ligne claire" et créateur de Blake et Mortimer, accordait à François Rivière et Olivier Martial Thieffin un long entretien, véritable voyage dans sa mémoire intime, récit de sa geste d'artiste et évocation de plus d'un demi-siècle d'histoire du neuvième art.
Après être revenu sur son enfance, sa jeunesse et l'amorce d'une double carrière graphique et lyrique, il revient longuement sur sa trajectoire dans l'univers de la bande dessinée.
Émission "Mauvais Genres", animée sur François Angelier.


 (0)
(0)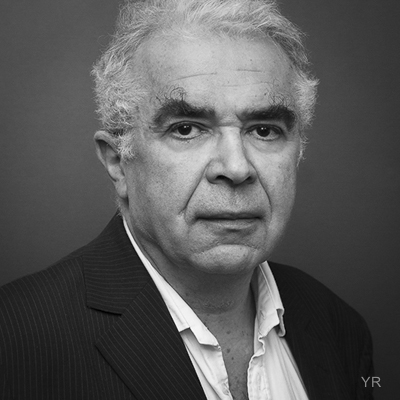
Imprévue et cependant régulière, toujours nouvelle et toujours intelligible, la mode n'a cessé d'intéresser les psychologues, les esthéticiens, les sociologues.
C'est pourtant d'un point de vue nouveau que Roland Barthes l'interroge : la saisissant à travers les descriptions de la presse, il dévoile en elle un système de significations et la soumet à une véritable analyse sémantique : comment les hommes font-ils du sens avec leur vêtement et leur parole ?
Émission "Les Chemins de la philosophie", animée par Adèle Van Reeth.