

 (0)
(0)
Hiver 1919-1921. Après 3 ans et demi le fiasco du pouvoir bolchevik est évident : énorme appareil politico-bureaucratique, soviets enchaînés, police politique (Tchéka) omniprésente, travailleurs asservis et affamés. Après l'éclatement de grèves, notamment à Pétrograd, les marins, ouvriers, soldats de Kronstadt (port de guerre de la Baltique) soutiennent les grévistes, réclament des soviets libres, condamnent le régime policier, les privilèges et les pouvoirs du Part bolchevik.
Début mars, Lénine parle d'un "mouvement petit-bourgeois anarchiste" et Trotsky envoie des détachements d'élite communistes, régiments d'élèves-officiers et sections de la Tchéka à l'assaut de Kronstadt...
Émission "Trous noirs".


 (0)
(0)
Face à la prise de pouvoir des Bolchéviks en Russie, les exilés en Europe ont tenté de s'organiser pour renverser le pouvoir rouge. Gagnant le surnom de "Russes blancs" ils ont manœuvré tout au long des années 1930. Certains se sont engagés durant la Seconde Guerre mondiale pour essayer de renverser Staline, en vain.
Retour sur l’épopée de ces Russes blancs avec Sylvain Roussillon.
Une émission présentée par Jean-Baptiste Noé.


 (0)
(0)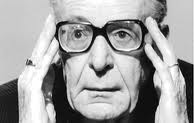
C'est avec précision qu'Henri Guillemin relate l'ascension politique et le règne de Staline. D'abord la répression en Géorgie dans les années 20 alors qu'il est encore sous l'autorité de Lénine, l'industrialisation forcée accompagnée de la déportation de plusieurs millions de paysans et enfin, dans les années 30, les assassinats de proches et les grandes purges. Après avoir expliqué le pacte qu’il passa le 23 août 1939 avec Hitler, il nous montre Staline face à l'armée nazie assiègeant Moscou fin 1941, alors qu'il prend le parti d'exalter le patriotisme russe avant de lancer la contre-offensive qui mènera l'Armée Rouge à Berlin en 1945.
En forme de conclusion, Henri Guillemin esquisse un portrait psychologique de Staline : il n'était pas "sadique" et il commit si l'on peut dire des crimes abstraits. Son comportement tyrannique, dans la lignée d'Yvan le Terrible et de Pierre le Grand, ne doit pas occulter le fait qu'il fut réellement pleuré par le peuple russe à sa mort.


 (0)
(0)
Quelle a été la matrice idéologique des fascismes ? Les régimes de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie partagent-ils une similarité de structure ? L'exercice de la dictature a-t-il contribué à reconfigurer l'idéologie qui avait pourtant été à l'origine de la naissance même du régime ?
Autant de questions auxquelles l'historien Olivier Dard, spécialiste de la période de l'entre-deux-guerres, donne réponse en se basant sur les recherches historiques les plus récentes.
Émission du "Libre Journal des historiens", animée par Philippe Conrad.


 (0)
(0)
La guerre froide a effrayé la planète pendant un demi-siècle. En 1989 puis en 1991, le rideau de fer est tombé. Dès lors, prédisait-on, le monde serait plus sûr, plus démocratique.
Mais y'a-t-il jamais eu de véritable menace soviétique ? La guerre froide a-t-elle été autre chose qu'une création américaine dans laquelle les européens se sont fait embobiner pendant plus de 50 ans ?
Il est plus que temps de rembobiner cette séquence historique et de la repasser avec un regard neuf et déuné d'a priori.


 (0)
(0)
L'histoire de l’Union soviétique – si elle mérite encore le nom d'histoire – se caractérise dans notre pays par l'absence de débat contradictoire. Le consensus politique veut que la droite attaque Staline comme incarnation-repoussoir de tout système socialiste et la gauche, comme symbole du fourvoiement de nobles idéaux. Imperturbablement donc, les opérations de propagande se succèdent sur le mode du film d'horreur, du Tyran rouge à l'Ombre de Staline et ce, jusqu'à l'eschatologique Apocalypse Staline.
L'actuelle réactivation des vieux "bobards" colportés par la guerre froide vise manifestement à exclure les communistes de l'espace public. Elle entre néanmoins en contradiction avec la tendance actuelle, liée à l'ouverture des archives de l'URSS, qui fait litière d'un certain nombre de légendes noires.
Étayée par une proximité avec de nombreux chercheurs et fruit d'une activité éditoriale concernant l'Union soviétique de près de quinze ans, le travail d'Aymeric Monville n'est pourtant pas dépourvue d'un esprit polémique et partisan. Mais quand le Parlement européen n'hésite plus, désormais, à décréter une équivalence entre nazisme et communisme, n'est-ce pas plutôt cette apparente "impartialité", indifférente à ce que Hitler ait gagné ou non en 1945, qu'il conviendrait d'interroger ?


 (0)
(0)
Hindenburg (1847-1934), président de la République de Weimar pendant dix ans, porte la responsabilité d'avoir appelé Hitler au pouvoir. Mais loin d'être une erreur de vieillesse, cette décision est dans le droit-fil de toutes ses positions antérieures. Elevé dans le culte de la grandeur et de la toute-puissance de l'Allemagne, il n'a jamais répugné à tomber dans l'excès voire l'extrémisme.
Couvert de gloire (largement usurpée) au début de la Grande Guerre alors même qu'il était déjà à la retraite, Hindenburg a ensuite constamment abusé de son image pour exercer le commandement suprême et surtout s'immiscer dans les affaires politiques, quitte à desservir les institutions et les personnes qu'il révérait pourtant le plus, rompant avec ses amis les plus proches et plaçant l'empereur Guillaume II lui-même dans des impasses. Pur produit de la caste des Junkers, il intrigue pour pousser les chefs militaires et politiques à la démission. Il impose la guerre sous-marine à outrance et refuse toute paix de compromis. Hindenburg a pris une large part aux malheurs de l'Allemagne et a été, après la guerre, le grand champion de la fiction du "coup de poignard dans le dos", l'argument massue des nazis pour fanatiser les foules allemandes.
Le grand spécialiste des mondes germaniques qu'est Jean-Paul Bled revient en détails sur la trajectoire de cet homme largement néfaste.
Émission des "mardis de la mémoire", animée par Anne Collin et Dominique Paoli.


 (0)
(0)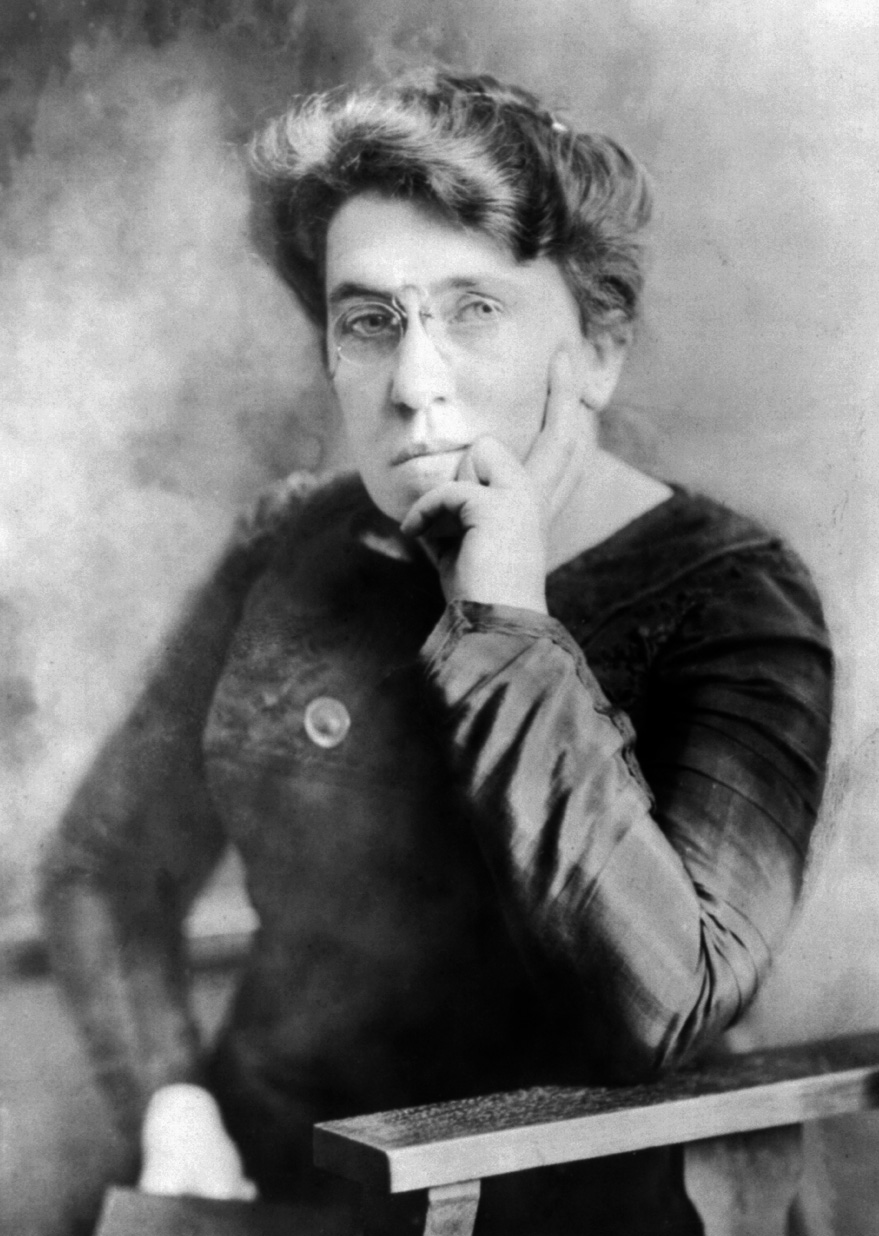
Emma Goldman nait dans l'empire russe, à Kaunas, en 1869. Émigrée aux Etats-Unis à seize ans, elle y devient anarchiste après l'exécution des "martyrs de Chicago" en 1887. Très tôt, elle est considérée comme la femme la plus dangereuse d'Amérique.
Ses positions sur la violence anarchiste, sa défense de la contraception et de l'amour libre, sa condamnation de la guerre et du patriotisme en font l'ennemie des autorités, mais suscitent également de houleux débats chez ses compagnons de lutte.
Emma Goldman ne se rend jamais : arrêtée, emprisonnée, empêchée de parler, elle continue à donner des conférences, à écrire, à lutter. Privée de sa citoyenneté américaine, elle est déportée en Union Soviétique en 1919. L'espoir qu'elle mettait dans la révolution est bien vite déçu, et elle dénonce l'autoritarisme du régime bolchévique.
Pendant les vingt dernières années de sa vie, elle erre, "femme sans pays", sans jamais renoncer à son engagement ; sa dernière grande cause fut celle des anarchistes engagés dans la guerre civile espagnole.
Après une vie passée à se battra pour défendre sa liberté et celle des autres, elle meurt en 1940 à Toronto ; sa dépouille repose à Chicago, à côté de celles des martyrs de Haymarket.
Émission "Une vie, une oeuvre", produite par Alice Béja.