

 (0)
(0)
Publié 10 ans après Comprendre l'empire, Comprendre l'époque n'est pas un livre comme les autres. C'est une odyssée conceptuelle qui remonte au racine grecques de la raison et de l'égalité. Une longue épopée qui aboutie à travers une mathématisation du monde, à un dévoiement de l'égalité pour la mettre au service de l'inégalité.
Un entretien mené par Rachid Achachi.


 (0)
(0)
Alors que sommes embarqués dans la grande accélération, qui menace aujourd'hui l'existence de la population humaine globale, Pablo Jensen tente un parallèle entre les logiques des révolutions scientifique et industrielle, qui mettent en place des circuits longs pour, respectivement, expliquer ou métaboliser le monde. La grande accélération serait alors produite par la synergie entre sciences expérimentales et industrie, menant à la création de boucles de rétroaction positive stables permettant d'aspirer et contrôler le monde.
Dans un premier temps, c'est la logique des premières étapes de la révolution scientifique qui est analysée en les reliant à celles de la révolution industrielle, grâce notamment à l'idée de "Engine Science" (Caroll-Burke, 2001).
Ensuite, et de manière plus générale, on se demande ce qu'on gagne et ce qu'on perd lorsqu'on passe d'un circuit court à un circuit long : quand on fait un détour par un laboratoire ou un centre de calcul pour maîtriser un phénomène ou quand on bâtit une usine de production de masse au lieu d'engendrer ses ressources localement.
Finalement, la conclusion est consacrée à l'exploration de ce parallèle entre sciences et machines en s'interrogeant sur la nécessité de refonder les sciences expérimentales pour les rendre "Terrestres".


 (0)
(0)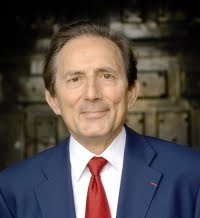
Des présocratiques à Plotin en passant par Socrate, Platon, Aristote, Épicure et les stoïciens, Jean-François Mattéi nous convie à un voyage initiatique dans la philosophie antique. C'est à cette source que la raison occidentale se nourrit depuis des siècles.
On y assiste à la naissance de la philosophie, de la physique, des mathématiques, de la politique : éblouissant feu d'artifice de la pensée comme l'histoire en a peu connu depuis lors, et qui continue de résonner dans les débats d'aujourd'hui.


 (0)
(0)
Au printemps 1944, un philosophe français qui s'était intéressé de très près aux mathématiques était fusillé par les Allemands dans la Citadelle d'Arras. Il venait d'avoir quarante ans et s'appelait Jean Cavaillès. Ce philosophe, qui avait été reçu major au concours d'entrée à l'Ecole Normale en 1923, n'aimait guère les tours d'ivoire. C'est pourquoi il fut aussi un combattant, un résistant, un chef de réseau, un homme d'action et même de coups de main : avec quelques copains, il fit gaillardement sauter des ponts, des transformateurs, des trains et des usines.
Jean Cavaillès fut en somme "un philosophe mathématicien bourré d’explosifs", pour reprendre les mots de Georges Canguilhem. Le mot explosif était ici à prendre au sens propre et au sens figuré, car sa pensée était elle aussi radicale : selon lui, la tâche de la philosophie est de substituer au primat de la conscience le primat du concept. La philosophie doit refuser le déclin de la preuve pour devenir fille de la rigueur, c'est-à-dire s'apparenter davantage aux mathématiques qu'à la littérature : philosopher, c'est démontrer, et non pas verser dans le psychologisme ; philosopher, c’est une affaire de concepts plutôt que l'épanchement des états d’âme de l'intellect. Car la recherche de la vérité réclame qu'on s'oublie un peu.
Si Cavaillès est entré en résistance, c'est non par appartenance à une ligne politique, mais "par logique" : la lutte contre l'inacceptable est inéluctable, donc nécessaire, un point c'est tout. Par lutte, il ne faut pas entendre l'indignation chuchotée dans les couloirs, le porte-à-porte patriotique ou l'alimentation des boîtes aux lettres en tracs vengeurs. Par lutte, il faut entendre ici le combat les armes à la main.
Arrêté et emprisonné à plusieurs reprises, évadé chaque fois sauf la dernière, il ne renonça jamais, ni à l'action la plus subversive, ni à la réflexion la plus abstraite. En 1942, dans la solitude héroïque d'une prison, il écrivit un ouvrage intitulé Sur la logique et la théorie de la science, qui ébranlera plus tard la scène philosophique.
Cavaillès fut arrêté par la Gestapo en août 1943, à Paris, puis condamné à mort et exécuté cinq mois plus tard, en février 1944. Son cadavre fut jeté dans une fosse commune, avec comme seule indication "l'inconnu n°5". Ceux qui le fusillèrent n'avaient sans doute pas à l'esprit que pour un philosophe mathématicien, être appelé l' "inconnu", cette chose que les mathématiques permettent de réduire calmement par le calcul, c'était la plus belle des épitaphes.
Mais qui donc était cet homme, Jean Cavaillès ?
Émission "Science en questions", animée par Etienne Klein.


 (0)
(0)
Le philosophe Benoit Bohy-Bunel nous propose une analyse critique suivie de la grande oeuvre de Kant, la Critique de la raison pure. Il s'agit d'une approche matérialiste, qui n'est pas économiciste, mais qui définit la matière comme rapports sociaux concrets entre corporéités agissantes.
La démarche idéologique kantienne s'inscrit dans une dépossession du travail manuel par le travail intellectuel. Dès lors, les facultés transcendantales de Kant perdent leur universalité et retrouvent leur perspective située : c'est le sujet masculin blanc et bourgeois qui s'arroge l'universalité, pour mieux assigner les individus minorisés qui sont considérés comme étant hors culture.
La chose en soi est définissable : elle est la souffrance des individus réifiés, que Kant ne veut pas (ou ne peut pas) thématiser. La dialectique transcendantale prend alors une tout autre signification, ainsi que tout le projet critique kantien.


 (0)
(0)
Chercheur génial, écologiste radical au début des années 1970, ermite retiré du monde pendant 23 ans, il a eu trois ou quatre vies successives entre sa naissance, le 28 mars 1928 à Berlin, et sa mort, en 2014, quelque part dans l'Ariège. Le monde des mathématiques l'a découvert en 1958, au congrès mondial d'Edimbourg, où il présenta une refondation de la géométrie algébrique. La géométrie algébrique, ce sera sa grande œuvre, une sorte de cathédrale conceptuelle construite en collaboration avec deux autres mathématiciens, Jean Dieudonné et Jean-Pierre Serre. De 1950 à 1966, il fit des mathématiques, seulement des mathématiques.
Mais un jour, il finit par découvrir la politique. En 1966, il refusa d'aller chercher sa médaille Fields à Moscou, où deux intellectuels venaient d'être condamnés à plusieurs années de camp pour avoir publié des textes en Occident sans autorisation. L'année suivante, il passa trois semaines au Vietnam pour protester contre la guerre lancée par les Etats-Unis. À partir de 1971, il consacra l'essentiel de son temps à l'écologie radicale à travers un groupe qui avait été fondé par un autre mathématicien, le groupe "Survivre et vivre". En août 1991, il choisit de disparaître dans un village tenu secret après avoir confié 20'000 pages de notes à l'un de ses anciens élèves.
Le nom d’Alexandre Grothendieck sonne un peu comme la promotion de l'évanescence dans l'ontologie radicale. Car sa disparition donne à croire qu'elle le résume et le raconte davantage que tout le reste. Le choix qu'il a fait de s'évader rétro-projette son ombre sur tous les événements antérieurs de sa vie. Comme s'il n’avait jamais eu d'autre intention que celle d'échapper un jour au commerce des hommes. Mais raisonner ainsi serait injuste, car ce serait oublier l'homme, ses vies et son œuvre, qui est monumentale et demeure en partie inexplorée.
Émission "La Conversation scientifique", animée par Etienne Klein.


 (0)
(0)
Les humains ne sont pas des robots. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et pourtant, on peut utiliser des nombres pour comprendre les comportements humains. Ceci, dans les domaines les plus divers, qu'il s'agisse des intentions de ventes, du taux de criminalité, ou de la propagation des épidémies.
Peut-on dès lors en déduire des lois qui permettent des prédictions ? Et de là, en tirer des décisions politiques ? Certains scientifiques le pensent.
Les mathématiques sont parfois utiles, mais où commence leur usage abusif ? Peut-on mettre l'humanité dans un logiciel informatique ? La société se laisse-t-elle mettre en équations ?
Émission "Autour de la question".


 (1)
(1)
Olivier Rey, c’est le Little Big Man de l'écologie bien comprise. Philosophe, mathématicien, romancier à hauteur d'homme.
Avec lui, l'écologie retourne dans la maison du père : la tradition, la conservation, le conservatisme, la bonne mesure — lui le penseur de la démesure inhumaine de nos sociétés.
Ses livres sont des antidotes. Les lire, c'est retrouver ce qu'il y avait de bon hier, sans renoncer à ce qu'il y a de bon aujourd'hui ni à ce que l'on pourrait faire mieux demain.