

 (0)
(0)
La guerre de l'information par le contenu est peu étudiée dans le monde académique ainsi que -malheureusement- dans l'appareil d'Etat.
C'est la raison pour laquelle Christian Harbulot, expert international en intelligence économique et directeur de l'Ecole de Guerre Economique, nous propose cette série d'émissions, démarche pédagogique visant à faire naître une réelle culture civile du combat par l'information.
Une série d'émission animée par Nicolas Moinet.


 (0)
(0)
Dans ce grand entretien, Pierre-Yves Rougeyron revient sur l'actualité politique du mois de février de l'année 2024.
Une analyse où les actualités nationale et internationale sont passées au crible de l'intérêt français souverain.
Nécro-actualités
- 0'01'22 : Norman Palma
- 0'15'50 : Robert Badinter
Actualités du Cercle Aristote
- 0'46'27 : Actualités du Cercle
Actualités nationales
- 1'00'14 : Gabriel Attal, couper l'herbe sous le pied du RN ?
- 1'10'59 : La Bruno le Maire du mois
- 1'48'16 : Mayotte
Actualités internationales
- 1'54'40 : L'arme nucléaire française pour l'Allemagne ?
- 1'59'00 : Pas de liste souverainiste unitaire aux européennes
- 2'12'23 : Elections aux Etats-Unis et potentielle guerre civile
- 2'34'11 : Interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson
- 2'41'17 : Conflits au Proche-Orient
- 2'54'08 : Chine, Inde, Japon


 (0)
(0)
Dans ce grand entretien mené par Davy Rodriguez, Pierre-Yves Rougeyron revient sur l'actualité politique du mois de mars de l'année 2023.
Une analyse où les actualités nationale et internationale sont passées au crible de l'intérêt français souverain.
- 0'00'00 : Introduction
- 0'03'10 : Actualité du Cercle
- 0'08'50 : Hommage à Pierre Legendre
Politique intérieure :
- 0'13'10 : Arnaud de Montebourg et la trahison de la France
- 0'45'35 : La réforme des retraites
- 1'01'20 : Pierre palmade
Politique internationale :
- 1'13'30 : Poutine, un an après le début du conflit ukrainien
- 1'43'35 : La fracture ukrainienne chez les natios
- 1'47'05 : Macron en Afrique
- 1'57'40 : La réécriture des grandes oeuvres
- 2'09'00 : Houria Bouteldja, l'extrême droite et l'expropriation culturelle
- 2'12'50 : L'avenir du Japon
- 2'14'20 : Le Pérou ratonné
Séance Q&A :
- 2'18'50 : Aujourd'hui, sommes-nous sous occupation ?
- 2'22'35 : Quel scénario pour le Frexit ?
- 2'25'20 : Une guerre civile aux USA ?
- 2'31'35 : La situation en Géorgie
- 2'33'30 : Macron et le mythe de la grève générale
- 2'37'35 : Un avis sur Eric Hobsbawm


 (0)
(0)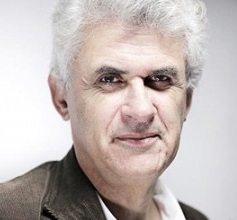
Nous plongeons ce matin dans l'époque d'Edo (1603-1867) durant laquelle l' "esprit de plaisir" s'épanouit au Japon, marqué par une sexualité débridée et des mœurs désinhibées. L'arrivée des Occidentaux à la fin du XIXe siècle corsètera le désir et bridera l'imaginaire érotique. À mi-chemin de la grivoiserie et de la pudibonderie, c'est donc de l'érotisme et de la sexualité au Japon que Pierre-François Souyri vient nous parler.
Il y a déjà belle lurette que l'historiographie la plus savante n'hésite pas à aborder des domaines qui auraient paru extravagants à la Sorbonne d'autrefois. Et à condition de considérer le sujet d'étude selon les mutations qu'il a pu connaître dans la longue durée des siècles, celui-ci a beaucoup à nous dire sur les équilibres et les déséquilibres successifs d'une société, selon les époques, entre la tolérance et la répression, entre les pratiques et les rêves, entre le dissimulé et l'ostensible.
Cela est fait, naturellement, depuis notre continent et nous invite à comparer ces deux mondes. D'abord parce que l'histoire comparative est en elle-même stimulante. Ensuite parce que l'influence des pays occidentaux, après qu'ils ont forcé l'ouverture de l'archipel, dans la décennie 1850, comme après l'effondrement de 1945, a été grande, à cet égard comme à d'autres. Mais sans qu'elle efface en profondeur l'originalité des comportements japonais dans le domaine du sexe et de l'amour.
Concordances et différences sont ainsi abordées de manière aussi spatiale que temporelle. En route donc, allègrement, vers ces rivages lointains.
Émission "Concordance des temps", animée par Jean-Noël Jeanneney.


 (0)
(0)
Après 1968, qu'est-il advenu de tous ceux, étudiants, ouvriers, militants qui n'ont pas pu se résoudre à abandonner le combat ? Comment sont-ils, chacun à leur façon, passés de la contestation à la lutte armée ?
Au Japon, en France, en Italie, en Allemagne, retour sur ces années de bascule où la violence s'est peu à peu imposée dans le paysage.
Série documentaire "LSD", produite par Kristel Le Pollotec.


 (0)
(0)
Que reste-t-il après l'apocalypse ? Quelle vie nous attend dans un monde dévasté par la guerre nucléaire, anéanti par la propagation d'un virus ou englouti sous les eaux d'un déluge cataclysmique ? Tel est précisément le type de situation que l'univers post-apocalyptique, qu'il soit celui du roman, du film ou du jeu vidéo, met en scène.
De ce point de vue, le manga occupe une place particulière car il tient précisément sa raison d'être de l'éclair nucléaire qui frappa et aveugla le Japon par deux fois, les 6 et 9 août 1945. Contrairement à l'Occident, l'Archipel vécut la table rase dans sa chair ; l'apocalypse ne fut pas pour lui une possibilité, mais bien une réalité effective : il fit l'expérience concrète de la faille généalogique et du déficit des origines qui forment le point de départ obligé du manga.
Le fil directeur de dernier essai de Baptiste Rappin, Hokuto no Ken, que l'on connaît en France sous le titre de Ken le survivant, s'inscrit tout naturellement dans cette perspective : les paysages de ruines y sont le théâtre d'une grande régression biologique caractérisée par la recherche d'eau et de vivres ainsi que par la loi du plus fort. Notre héros n'a-t-il d'autre alternative que de plier à ce nouveau nomos de la terre ?


 (0)
(0)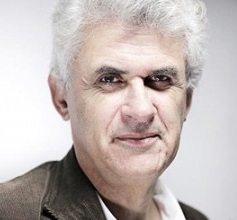
15 août 1945 : l'empire colonial japonais s'effondre. Rapatriement dans des conditions épouvantables de milions de civils et de militaires, effondrement de l'idéologie impériale nationaliste, début de la décolonisation.
S'ouvre une nouvelle page de l'histoire du XXe siècle que nous raconte l'historien Pierre-François Souyri.


 (0)
(0)
Les différentes interventions visent à brosser un tableau de l'État-continent chinois et des transformations qu'il connaît depuis la signature du premier des traités "inégaux" jusqu'à la prise de pouvoir du Parti Communiste Chinois.
Les quatre spécialistes qui interviennent s'attachent à mettre en lumière, selon des logiques thématiques, les mutations politiques, sociales ou encore économiques qui marquent alors la Chine, ainsi que l'évolution de ses relations avec l’étranger. La mise au jour de la conjonction de facteurs endogènes et exogènes permet d'évoquer également les repositionnements de l'historiographie.
Marianne Bastid-Bruguière intervient sur "le nationalisme chinois (1842-1949)", David Serfass évoque "la Chine au prisme du Japon (1871-1949)", Xiaohong Xiao-Planes traite de la "participation politique et acteurs sociaux (1842-1949)" et Laurent Galy présente "les villes chinoises et l'histoire urbaine de la Chine".