

 (0)
(0)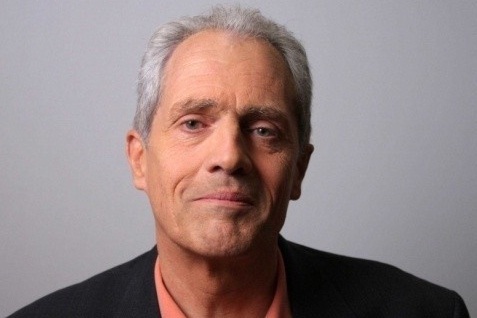
Avec la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe et la montée des affrontements - aujourd'hui verbaux et "à distance"- entre la Russie et les puissances de l'OTAN, le professeur de sciences politiques et membre de l'Académie des Technologies Jean-Pierre Dupuy estime que "nous sommes plus près d'une guerre nucléaire que nous ne l'avons jamais été pendant la guerre froide".
Dans son livre de 2019 La guerre qui ne peut avoir lieu. Essai de métaphysique nucléaire, réédité en 2022, il "démonte" notamment la fameuse théorie de la dissuasion avec laquelle nous, Français, avons tous été élevés.


 (0)
(0)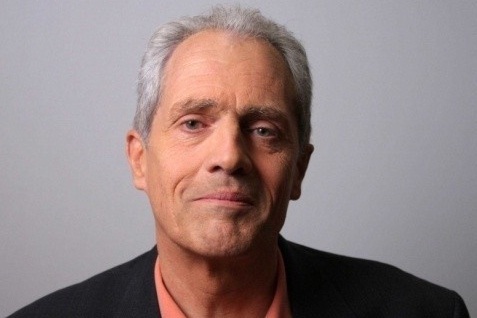
En quoi la possibilité de la guerre nucléaire confirme ou altère-t-elle les analyses développées par René Girard et Benoît Chantre dans leur livre Achever Clausewitz ? Celui-ci met en scène classiquement l'opposition entre l'attaque et la défense et démontre la primauté de cette dernière.
Avec l'arme atomique, on a affaire à trois termes, et non pas deux : la défense, l'attaque, nommée "préemption", et la dissuasion. Jean-Pierre Dupuy démontre que la défense est mise hors circuit, tant pour des raisons techniques que par le fait que la dissuasion implique que l'on ne se défende pas : on prouve ainsi à l'ennemi qu'on ne l'attaquera pas en premier. Il montre aussi que dans l'histoire de l'ère nucléaire, la préemption l'a emporté sur la dissuasion et que les chefs d'État soviétiques russes et américains n'ont jamais exclu de leurs répertoires d'action la décision de frapper en premier.
Jean-Pierre Dupuy illustre finalement ces thèses par cette question lancinante : si Poutine perd la guerre conventionnelle contre l'Ukraine, aura-t-il recours contre les puissances de l'OTAN à ses armes nucléaires tactiques, domaine dans lequel il est de loin le plus fort ?


 (0)
(0)

 (0)
(0)
Dans une riche synthèse, l'ancien officier Michel Goya analyse la "petite guerre mondiale" menée par la France ces soixante dernières années. Une histoire assez largement méconnue qui n'avait jamais été traitée sous cette forme.
- 0'04'30 : L'angle et la nécessité de l'ouvrage
- 0'06'00 : La facilité d'emploi des forces armées sous la Ve République
- 0'13'30 : Les engagements en Afrique depuis la présidence du général de Gaulle
- 0'24'30 : Les années 1980, les "soldats de la paix" au Liban et au Tchad
- 0'41'30 : L'engagement au Rwanda et les ferments du désastre
- 0'49'00 : La guerre du Koweït et la place de la France dans l'après-guerre froide
- 0'55'05 : Le livre blanc de 1994, la réorganisation des armées et les problèmes budgétaires
- 1'03'30 : Les années casques bleus
- 1'22'00 : Réussites et échecs des OPEX françaises
- 1'34'00 : Dimensionnements et investissements pour les armées françaises de demain
Émission "Le Collimateur", animée par Alexandre Jubelin.


 (0)
(0)
Après une période où les conflits moléculaires et asymétriques semblaient être devenus la norme, la guerre d'Ukraine ressuscite les guerres traditionnelles interétatiques.
Mais quelles transformations pouvons-nous observer dans la conduite de l'art de la guerre ? Quelles seront les nouvelles normes des conflits futurs ?
Autant de questions que Bernard Wicht développe en prenant appuit sur les enseignements que nous pouvons tirer de la guerre en Ukraine.


 (0)
(0)
Le 12 janvier 2023, Le Figaro publiait un entretien accordé par Emmanuel Todd sous un titre alarmant : La troisième guerre mondiale a commencé. Les grands médias français ne firent pas écho aux thèses exprimées au cours de l'entretien, dont le texte fut pourtant repris et commenté dans le monde entier.
Sur les enjeux de la guerre en Ukraine, il était indispensable d'organiser un débat sans apriori ni passion. Economiste, spécialiste l'économie russe et des questions stratégiques, Jacques Sapir a accepté de confronter ses analyses à celles d'Emmanuel Todd, démographe et géopoliticien. La discussion porte sur les motifs de l'intervention russe en Ukraine, sur la situation militaire après un an de guerre et les issues qui peuvent être aujourd'hui envisagées.
- 0'00'00 : Introduction
- 0'01'52 : Jacques Sapir commente la tribune d'Emmanuel Todd
- 0'19'51 : Réponse d'Emmanuel Todd
- 0'47'48 : 3 scénarii de fin de conflit
- 1'21'17 : Vision historique et anthropolique de la situation en Ukraine
- 1'35'22 : Et la France dans tout ça ?
- 1'46'52 : Questions du public


 (0)
(0)

 (0)
(0)