

 (0)
(0)
Valérie Bugault, avocate spécialisée en fiscalité internationale et militante à l'UPR, nous présente une double conférence où est exposé le fonctionnement des institutions de l'Union européenne.
Conférence n°1 : les institutions de l'UE
1. Comparaison de la répartition et de l'exercice des pouvoirs exécutif, juridictionnel et législatif dans la Ve République française et dans l'UE
2. Analyse juridique et géopolitique des pouvoirs "fédéralistes" spécifiques à l’UE : l’organisation régionale et le pouvoir financier
3. Détails des processus décisionnels au sein de l’UE
Conférence n°2 : les grandes tendances de l’UE
1. La liberté professionnelle
2. La liberté de circulation des marchandises
3. La liberté de circulation des capitaux et son corrolaire, l’organisation des paradis fiscaux
4. L’assujettissement militaire à l’OTAN et ses conséquences pour la France


 (0)
(0)
Longtemps la démocratie a eu mauvaise presse, notamment dans les pays où elle s’est installée la première à la faveur d’une révolution, en France ou aux États-Unis. Çela peut paraître étrange aujourd’hui, alors que ce régime est en passe de s’étendre à l’ensemble de la planète et que les ONG de la bonne gouvernance, qui soutiennent partout dans le monde le passage des anciennes dictatures à la démocratie en vantent les qualités indépassables, jointes à celles de l’économie de marché.
Pourtant, dans le vocabulaire politique, à commencer par celui des "pères fondateurs" des démocraties modernes, le mot était affecté d’une fâcheuse connotation de désordre, de démagogie, de tyrannie du grand nombre, de revanche des pauvres et des sans-grades. À ces époques le mot renvoyait à ce que nous appellerions aujourd’hui la "démocratie directe". Et pour les hommes qui firent la révolution en France, tout comme pour ceux qui réalisèrent l’indépendance des Etats-Unis, le terme et l’idée qu’il suggérait avait tout d’un repoussoir.
C’est ce paradoxe que va explorer Francis Dupuis-Déri des deux côtés de l’Atlantique.
Il détaillera également plusieurs expérimentations démocratiques qui ont eu lieu dans notre histoire, dans les communautés d’habitants au Moyen-Âge en France ou les sociétés amérindiennes par exemple.


 (0)
(0)
Des démocrates athéniens à Montesquieu, d'Aristote à Rousseau, personne ne songeait à faire de l'élection l'instrument démocratique par excellence. Démocratie n'équivalait pas à gouvernement représentatif : c'est le tirage au sort qui paraissait le plus apte à respecter l'égalité stricte des candidats.
Que s'est-il passé au tournant du XVIIIe siècle, en Europe et aux Etats-Unis, pour que se renverse cette conception multiséculaire et pour qu'advienne l'idée qu'une démocratie est, par essence, un gouvernement représentatif ?
Bernard Martin montre que le système représentatif n'a pas pour seule fonction de permettre au peuple de se gouverner lui-même.
Le gouvernement représentatif mêle en fait des traits démocratiques et aristocratiques. L'élu n'est jamais le double ni le porte-parole de l'électeur, mais il gouverne en anticipant le jour où le public rendra son jugement.


 (0)
(0)
La question démocratique est généralement abordée de deux façons. La première pense que la démocratie représentative développée en Europe occidentale et en Amérique du Nord a vocation à s’étendre peu à peu à l’ensemble de la planète. La seconde pense que certaines cultures ne sont pas réceptives à la démocratie.
Or, les travaux récents d’histoire globale et d’histoires connectées imposent un décentrement du regard, sur la base d’une historicité polycentrique et plus complexe. L’avance de l’Occident est relativisée par une prise en compte du long terme, par une réévaluation des modes de développement non-occidentaux et par la mise en avant de différences fortes à l’intérieur du monde occidental.
En s’appuyant sur cette nouvelle historiographie, comment peut-on analyser globalement la démocratie en ce début de XXIème siècle ?


 (0)
(0)
Dans notre régime libéral, les élections et la représentation politique semblent renvoyer à l’idée de démocratie.
Pourtant, dans l’histoire de la pensée politique et des luttes sociales, la démocratie a souvent été une force qui s’opposait aux élites monarchistes ou aristocratiques, y compris à l’ "aristocratie élue" (les parlementaires).
Ainsi entendue, la démocratie est non seulement incompatible avec la représentation politique, mais elle en est même l’ennemi philosophique et politique.
Pour illustrer cette tension ou ce conflit, il convient d’effectuer un retour à l’époque de la fondation des régimes parlementaires modernes, ainsi que de rappeler la logique politique de quelques conflits récents, par exemple le "Printemps érable" qui a soulevé de vifs débats au sujet de l’idéal démocratique.


 (0)
(0)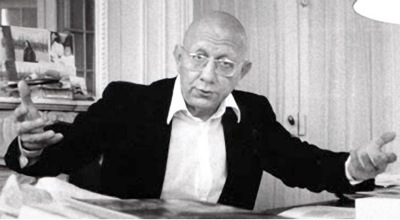
Dans cette conférence, Cornélius Castoriadis s'attache à un réexamen fondamental des bases de la pensée philosophique. Il retrouve et souligne les préceptes de la "pensée héritée", cette logique identitaire qui, depuis les Grecs, inspire la philosophie classique. D'où la proposition d'une "auto-institution" de la société qui laisserait cours, enfin, à l'imaginaire radical.
Fruit d'une analyse précise de l'histoire et des luttes sociales à l'heure de l'effondrement des repères traditionnels de la pensée, le travail de Castoriadis propose un point de départ pour penser à neuf le projet de transformation de la société.
Remarque : la conférence est présentée en bilingue français-portugais.


 (0)
(0)
En France, est répandue depuis plus de 40 ans une histoire réactionnaire de la Révolution propagée des ouvrages "savants" aux manuels des écoliers. Ce déni, instrumentalisé par l'oligarchie qui l'a promu, s'accompagne d'une "haine de soi" qui suscite la perplexité goguenarde des historiens du monde entier.
Les conséquences grotesques de cette propension au "devoir de mémoire" patrimonial revendiqué contre l'intelligibilité du développement historique ont pourtant fini par disqualifier ces scolastes aux yeux de celles et ceux qui entendent faire de l'histoire quelque chose du présent, qui y cherchent une source généalogique de savoir et de sens.
Le magnifique travail de Sophie Wahnich atteste qu'une nouvelle génération d'historiens à donc su de ce passé récent "faire table rase", et nous restituer la portée sociale fondatrice et universelle de la Révolution, en révélant l'imposture des apories que 40 années de refoulement avaient postulé entre "sentiment et raison", "violence et progrès", "individu et collectivité".
En nous réappropriant, avec Sophie Wahnich, ce moment de notre histoire où l'être social de la Nation a réussi a s'exprimer, et pour toujours être entendu du monde entier, nous pouvons de nouveau en faire quelque chose, aujourd'hui, en ces temps obscurs de relativisme généralisé et de concurrence libre et non faussée, pour... en sortir !


 (0)
(0)
Comment défendre aujourd’hui la démocratie directe en Suisse, sans immédiatement passer pour un populiste obtus, fourrier des idées et du programme de l’UDC et aveugle aux diverses manipulations subies par un peuple idéalisé ?
À partir de son livre "Défendre la démocratie directe", Antoine Chollet tente l’exercice en rappelant quelques-uns des principes fondateurs de la démocratie : la souveraineté populaire, l’égalité entre citoyens et l’autonomie comme projet. En effet, on ne doit jamais oublier que la démocratie est au moins autant une pensée qu’une pratique.
Sont évoquées également les réalités politiques suisses passées et présentes, les conditions d’exercice de la démocratie, les dangers qui la menacent et les moyens de la pérenniser.
Dans ce débat où ne semblent aujourd’hui s’affronter que les thuriféraires d’un peuple "qui a toujours raison" et les membres d’une élite éclairée et sage, il est important de montrer qui ni les uns ni les autres ne défendent la démocratie pour ce qu’elle est vraiment: un régime certes incertain et risqué, mais pourtant seul capable de préserver la liberté de chacun et de tous.