

 (0)
(0)
Mais que se passe-t-il au pays de Descartes et de Voltaire ? Pourquoi, sous couvert de démocratie, la liberté d'expression s'amenuise-t-elle toujours plus ?
Pour en débattre, sont rassemblées Natacha Polony, journaliste, essayiste et directrice de la chaîne Polony TV, ainsi qu'Elisabeth Lévy, journaliste, essayiste et directrice du journal Causeur.


 (0)
(0)
La traduction récente de Caliban et la sorcière de Silvia Federici aux éditions Entremonde/Senonevero est l'occasion, premièrement, de présenter cette oeuvre au public francophone et, deuxièmement, de faire l'histoire de l'émergence du patriarcat moderne et de "l'accumulation primitive" d'éléments constitutifs du patriarcat capitaliste
Après une présentation de l'édition française du livre et de Silvia Federici sont présentées les grandes thèses de l'ouvrage : écrasement des révoltes millénaristes des paysans aux 14e-15e siècles puis contre-révolution des groupes dominants (prise de contrôle de la reproduction, réification idéologique du corps, chasse aux sorcières meurtrière, enclosures, première colonisation et enfin criminalisation de la contraception, de l'avortement, de l'infanticide et de la prostitution).
S'en suit une discussion critique autour des problèmes de rigueur historique, de périodisation du capitalisme (absence de conceptualisation de l'Ancien Régime comme société distincte du féodalisme et du capitalisme), du "patriarcat salarié", de définition du capitalisme, d'espace d'émergence du capitalisme, de lien entre capitalisme et première colonisation, de lien entre "l'accumulation primitive" historique et des phénomènes contemporains, de lien entre enclosures et chasses aux sorcières et enfin d'idéologie altercapitaliste des communs.
Émission "Sortir du capitalisme", animée par Armel Campagne.


 (0)
(0)
Pourquoi cet épisode de l'histoire contemporaine se rappelle-t-il si souvent à notre mémoire ? Et alors que certains s'y opposent franchement, d'autres le commémorent : pourquoi ? Il en va probablement de l'identité et de l'avenir de l'être collectif qui s'identifie à cette séquence historique, comme modèle ou comme repoussoir.
Sur le plan historique il s'agira donc d'évoquer la signification et les causes de "l'évènement Mai 68", sa portée au présent et de "tirer des leçons de l’histoire". Or, l'histoire de Mai 68 n'a pas encore été réellement écrite. Le serait-elle dans sa véracité qu'elle en plongerait plus d'un dans un abîme de perplexité, notre époque ayant porté au sommet d'un art majeur la pratique de l'occultation et de la manipulation.
Néanmoins des voix discordantes commencent à se faire entendre à contre-courant des versions officielles...
Une conférence conjointement organisée par la Revue Eléments, la Revue Rébellion et le Cercle Politeia.


 (0)
(0)
Pour ce grand entretien, Pierre-Yves Rougeyron revient sur l'actualité politique et géopolitique de janvier 2018.
Une analyse où les actualités nationale et internationale sont passées au crible de l'intérêt français souverain.
PARTIE 1 :
- Actualité du Cercle Aristote
POLITIQUE INTERIEURE
- Notre-Dame-des-Landes
- Réforme du BAC, réforme de l'enseignement
- L'état du souverainisme en France
- L'obligation vaccinale
- Harcèlement sexuel et le renversement de la charge de la preuve
- Censure de Céline et de Maurras et épuration de la culture française
- Le délire des Fake news
PARTIE 2 :
POLITIQUE EXTERIEURE
- La question Kurdes
- Élection anticipée vénézuélienne
- Que faire en cas d'explosion sociale en Algérie ?
- Perspective d’une alliance militaire latine et méditerranéenne
- La France doit-elle s’engager dans la nouvelle route de la soie ?
- Hypothèse d'un contre axe France/Grande-Bretagne/Sud de l’Europe
- Le retour de Berlusconi
- Les enjeux pour la formation du gouvernement Allemand
- L'obligation des pesticides dans le Bio
- Macron en Chine
- Libre-échangisme et partenariat économique UE/Japon
- La réforme fiscale de Trump et la crise systémique à venir
- L'avenir de l’Euro à court terme.
- Doctrine : Chaban-Delmas
- Disparition de Dolorès O'Riordan chanteuse de The Cranberries
- Digression sur la sortie du film Les heures sombres consacré à Winston Churchill
- Hommage à Daniel Lindenberg et Christian Malis


 (0)
(0)
Christine Delphy, sociologue, théoricienne critique de l’oppression et de l’exploitation des femmes, co-fondatrice du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) et du Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC), nous raconte son histoire militante.
C'est d'abord l’histoire du groupe Féminin, Masculin, Avenir renommé ensuite Féminisme, Marxisme, Action, puis l’importance de la non-mixité féministe, la lutte interne avec Antoinette Fouque et les féministes différencialistes, la manifestation du 26 août 1970, ses slogans ("Un homme sur deux est une femme" et "Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme") et sa répression, les différentes tendances du MLF dont celle "lutte-de-classes" d’Eliane Viennot (LCR), l’essor du MLA en 1971 et sa transformation en MLAC – véritable instigateur de la loi de 1974-75 légalisant l’avortement et la contraception –, le Manifeste des 343, les manifestations pour l’avortement libre, l’organisation de l’avortement illégal (qui auparavant faisait des dizaines de milliers de morts chaque année) et surtout l’incroyable transformation subjective de ces milliers de femmes ayant participé aux luttes des femmes des années 1968.
Une histoire à connaître alors que le renouveau actuel des luttes anti-patriarcales puise largement son inspiration dans ce qui a été fait en 1968 et pendant les années qui ont suivies, soit ce que l'on désigne comme la "seconde vague du féminisme".


 (0)
(0)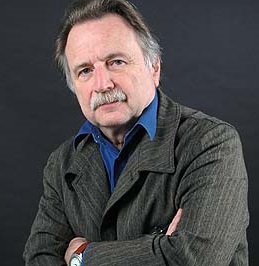
De quelles natures sont les relations transatlantiques ? Quels produits, quelles attitudes, quelles images avons-nous échangés, partagés ou déclinés ? Que doit concrètement l’Europe à l’Amérique et que doit l’Amérique à l’Europe ?
Une série d'émissions où Périco Legasse, Olivier Abel, Francis Marmande, Françoise Gaillard, Paul Soriano, Bernard Cerquiglini, Alban Cerisier, Benoît Peeters, Catherine Bertho-Lavenir et Raphaëlle Moine accompagnent Régis Debray dans son questionnement.


 (0)
(0)
Alors que la parole des femmes et la chasse à l'homme se sont libérés depuis l'affaire Weinstin et la campagne #balancetonporc, le philosophe Alain de Benoist, dans ce nouveau numéro des "Idées à l’endroit", nous convie à un débat sur le statut de la condition féminine après un bon siècle de luttes féministes.
Autour de lui, un plateau de choix avec la directrice de Causeur Elisabeth Levy, la rédactrice en chef de Boulevard Voltaire Gabrielle Cluzel et l’écrivain et chercheur Ingrid Riocreux.


 (0)
(0)
Nous savons que la trajectoire empreintée par notre modernité nous emmène au désastre. Et pourtant, il nous semble impossible de la modifier.
En outre, les questions qui ont mobilisé des générations de penseurs - la vie telle qu'on aimerait vraiment la vivre, le sens d'une existence humaine - tendent à disparaître de l'horizon du pensable.
Comment l'idéal moderne de liberté, dont l'affranchissement de la tradition constitue le fondement, a-t-il pu nous entraîner aussi loin dans l'égarement ?