

 (0)
(0)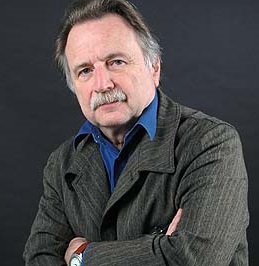
Diminution des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution des sols, de l'eau, de l'air, déforestation rapide, sans oublier, bien sûr, le changement climatique d'origine anthropique. En ces domaines, tous les indicateurs sont alarmants et toutes les projections sont inquiétantes.
Aujourd'hui, qu'allons nous faire de l'angoisse écologique ? Que se passe-t-il donc ? Qu'est ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, se construit ? Qu'est ce qui s'y détruit ? Nous l'ignorons pour une grande part, mais c'est paradoxalement parce que nous avons compris quelque chose. Nous avons compris que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous.
Dès lors, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire ? Nous sommes désormais conscients que nous grignotons de plus en plus avidement le fruit terrestre de taille finie qui nous porte, mais nous ne savons pas comment enrayer cette mauvaise tendance. Alors nous pressentons que cet avenir même que nous sommes en train d'anticiper par nos actions aussi bien que par nos inactions, pourrait se révéler radicalement autre. Et au fond de nous mêmes, nous le craignons.
Régis Debray, écrivain et philosophe, nous éclaire sur le concept d'angoisse écologique, à l'occasion de la sortie de son ouvrage Le siècle vert. Un changement de civilisation (Gallimard, 2020).
Émission "La Conversation scientifique", animée par Etienne Klein.


 (0)
(0)

 (0)
(0)
Et si notre "conscience environnementale" planétaire contemporaine n'était pas si nouvelle que cela ? Et si ignorer les réflexivités environnementales des sociétés du passé nous pénalisait pour envisager l’avenir des bouleversements planétaires en cours ?
Depuis un demi-millénaire, la définition des richesses, des équilibres et des limites de la Terre, de son "bon usage", durable et rationnel, est un enjeu de pouvoir. Plutôt qu'un récit de "prise de conscience" progressive des altérations causées à la planète Terre, de récents travaux d'histoire environnementale ont mis en lumière l'ancienneté – et l'historicité – des réflexivités environnementales.
A mesure que l'Europe étendait son empire sur le monde, ses élites religieuses, politiques, économiques et savantes ont forgé des discours et des savoirs d'un "bon usage" de la Terre entière. Un seul exemple : de Christophe Colomb au Comte de Buffon, une théorie du changement climatique à grande échelle a participé à la légitimation du projet de prise de possession européenne de l'Amérique.
Après avoir esquissé les enjeux d'une telle histoire de la constitution de la Terre entière comme objet de savoir et de pouvoir, la communication de Christophe Bonneuil met l'accent sur un moment particulier de ce géopouvoir, celui de l' "âge des empires" de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
Une communication qui s'inscrit dans le cadre des conférences "Comprendre et Agir", organisées par l'équipe de recherche STEEP.


 (0)
(0)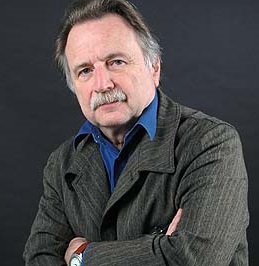
Un autre monde est en train de naître devant nos veux. Un autre esprit, dans nos façons de penser, d'espérer et d'avoir peur. L'angoisse écologique n'annonce rien moins, pour notre civilisation, qu'un changement d'englobant. Ce fut l'Histoire, ce sera la Nature...
Émission "Répliques", animée par Alain Finkielkraut.


 (0)
(0)
Alors que la finance occupe une place toujours croissante de notre économie, est-il possible de la réguler et de financer une réindustrialisation verte ? Emmanuel Macron aura-t-il la capacité de conduire cette véritable transition écologique ?
Nouvelle économie des communs, fragilité et instabilité du système financier, dérive illibérale du gouvernement, question religieuse, laïcité et écologie : l'économiste et prêtre jésuite Gaël Giraud nous offre un panorama de la situation actuelle dans un discours clair et didactique.


 (0)
(0)
Philosophe de formation, traducteur, Pierre Madelin vit depuis 2012 dans l'État mexicain du Chiapas et est l'auteur de l'essai Après le capitalisme : Essai d'écologie politique (Écosociété).
Lui est ici donné l'occasion de s'exprimer sur l'écologie politique, d'une manière dont ne parleront jamais les grands médias, trop occupés à promouvoir le "capitalisme vert", le "développement durable" et autres technique de greenwashing.
Critiquant vertement le capitalisme, Pierre Madelin tente de tracer une voie de sortie décroissante, radicale et libertaire.
Un entretien accordé dans le cadre des rencontres d'été à Montferrier de l'association Crise & Critique autour du thème "Crise et Critique du capitalisme-patriarcat".


 (0)
(0)
Interdire tout ce qu'on peut, éco-taxer le reste : telle pourrait être la devise des écologistes en politique. Si le CO2 humain est le problème, alors l'homme doit être bridé, contrôlé, brimé dans chacune de ses activités émettrices de CO2 : c'est-à-dire l'intégralité de son agir.
Fouillant l'écologisme depuis la racine de son éthique anti-humaniste jusqu'à la cime de ses revendications concrètes — bannir la voiture, l'avion, la viande, le nucléaire, la vie à la campagne, l'économie de marché, l'agriculture moderne, bref la Modernité depuis 1750 — Drieu Godefridi montre que l'écologisme définit une idéologie plus radicale dans ses prétentions liberticides, anti-économiques et finalement humanicides qu'aucun totalitarisme des siècles précédents.
"Diviser l’humanité par dix” : tel est l'idéal écologiste...


 (0)
(0)
Des feux ravageant des milliers d'espèces animales et végétales aux pandémies, en passant par le dérèglement climatique, tout conspire à signer la faillite du projet moderne de contrôle intégral de la nature par l'ingénierie humaine. L'effondrement des sociétés industrielles deviendrait sinon certain, du moins probable. À l'ombre de ce curieux futur sans avenir, les nouvelles consciences politiques sont façonnées par un discours écologiste effondriste, qui ne cesse de s'étendre.
Voilà qui paraît encourageant. À ceci près que cette collapsologie, autrement dit l'étude des effondrements passés, présents et à venir, et des moyens de s'y préparer, pourrait bien n'être qu'une énième recomposition du Spectacle. Cet ensemble de constats scientifiques, de grandes orientations éthiques et de conseils pratiques de survie participe de l'occultation d'une part de l'écologie politique. Celle qui a pourtant mené la critique la plus pertinente du capitalisme industriel, et a proposé les voies les plus sûres pour en sortir. En ce sens, la collapsologie est l'écologie mutilée.
Une conférence donnée dans le cadre des rencontres d'été à Montferrier de l'association Crise & Critique autour du thème "Crise et Critique du capitalisme-patriarcat".