

 (0)
(0)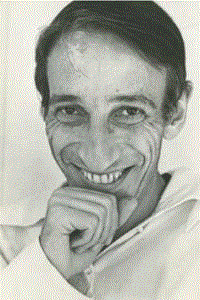
C'est au travers des expériences des uns et des autres et de leur rapport à Ivan Illich que nous mesurons le travail de l'oeuvre du philosophe autrichien.
Universitaire ou acteur associatif, du monde économique ou de la politique, c'est toute une génération qui a été influencée par Ivan Illich et ses thèses radicales.
Une invitation à (re)découvrir la postérité et la portée de sa pensée.
La table ronde est organisée dans le cadre du colloque "Vivre et penser avec Ivan Illich. Dix ans après."


 (0)
(0)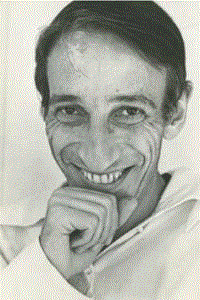
Si Ivan Illich s’est intéressé à un très grand nombre de sujets, sa pensée n’en a pas moins une profonde unité. Illich a lui-même donné quelques indications sur ce qui fonde cette unité : "Je crois que le thomisme –ou plutôt Thomas, que j’ai redécouvert grâce à Jacques Maritain– a imprégné ma pensée, ma vie, mon expérience, et que je lui dois cette structure intellectuelle qui m’a permis d’aller de Hugues de Saint-Victor à Kant, et de Schutz –ou Dieu sait quel autre étrange auteur allemand– à Freud, voire de pénétrer dans le monde de l’islam, sans jamais me disperser."
Dans ce sillon s’enracine l’extrême sensibilité d’Illich à la notion d’échelle pertinente. Leopold Kohr, qu’il a côtoyé à Porto Rico, a attiré son attention sur l’importance cruciale de la taille des sociétés humaines, et une très grande partie des travaux d’Illich peuvent être envisagés comme une généralisation des idées de Kohr. La question de l’échelle est un impensé de la tradition philosophique occidentale, qui met un point d’honneur à définir des concepts sans jamais s’inquiéter des bornes quantitatives entres lesquelles ces concepts ont un sens. Les réflexions d’Illich sont un remède à cet impensé. Dans tous les domaines où elles se sont portées, elles ont mis au jour les liens étroits qui unissent le bien à ce qui a la bonne taille – une taille au-delà de laquelle ce qui servait la vie se met à lui nuire et à la détruire.
La conférence est donnée dans le cadre du colloque "Vivre et penser avec Ivan Illich. Dix ans après."


 (0)
(0)
Quel est le mode d'existence des oeuvres d'art ? Comment peut-on leu attribuer des propriétés esthétiques ? Quel rapport entretiennent-elles avec les pratiques sans lesquelles elles n'existent pas ? Pourquoi pensons-nous qu'une reproduction de La Joconde n'est pas l'oeuvre de Léonard de Vinci ? Qu'est-ce qui distingue les multiples interprétations de la IXe Symphonie de Beethoven de l'oeuvre elle-même ?
Pour répondre à ces questions, il convient d'appliquer aux oeuvres d'art les concepts les plus fondamentaux de la métaphysique, ceux d'existence et d'identité.
Roger Pouivet défend la thèse que les propriétés esthétiques, attribuées aux œuvres d'art, à commencer par la beauté, surviennent sur les choses auxquelles nous les attribuons.
Même si les conditions pour l'objectivité des attributions de propriétés esthétiques sont difficilement réunies, elles ne sont difficilement réunies, elles ne sont pas des projections subjectives.
L'ontologie de l'œuvre d'art permet ainsi de répondre à certaines des questions principales de l'esthétique et à nos interrogations sur la nature des oeuvres d'art.


 (0)
(0)

 (0)
(0)
Comme on sait, la langue grecque ne disposait que d’un seul mot, logos, pour dire le langage et la raison. C’est, en un sens, une fâcheuse ambiguïté et, en un autre sens, une heureuse coïncidence.
Nous voudrions montrer ce que perd la faculté de penser "rationnellement" à être envisagée séparément de l’aptitude à parler, dans sa double dimension : parler de (quelque chose) et parler à (quelqu’un). Sans l’assise du langage, la raison déraisonne.
Nous tenterons de le montrer sur deux exemples : d’un côté l’argument idéaliste est irréfutable, mais il implique la perte de tout rapport au monde, lequel est donné immédiatement par la structure prédicative du langage ; d’un autre côté, l’argument réduisant à néant l’identité du moi est tout aussi irréfutable, mais il implique la perte de tout rapport à soi, lequel est donné immédiatement par le "je" et la structure indicative du langage.
Inversement, nous nous efforcerons de suggérer ce que, positivement, "la" raison doit au langage, en particulier ce que ses deux principes constitutifs les plus généraux, le principe de contradiction et celui de raison suffisante, doivent à la structure du langage humain.


 (0)
(0)
L’anthropologie du "tournant ontologique" occupe une place paradoxale dans le paysage des sciences de l’homme, entre d’un côté un paradigme "structuraliste" dont elle est l’héritière (avec ses présupposés conceptuels et ses conséquences méthodologiques) alors qu’elle en refuse le concept fondateur, celui de l’opposition nature et culture ; et d’un autre côté le nouveau paradigme "naturaliste", dont elle partage certaines des positions théoriques (notamment le refus de la frontière homme/animal — on a pu ainsi parler de son "tournant animaliste") alors qu’elle en refuse le fondement universaliste.
Cette position instable lui permet-elle de faire le pont entre les deux paradigmes qui se disputent actuellement le champ des sciences de l’homme ? Ou condamne-t-elle ses concepts, et notamment ceux de "nature" et de "culture", à une tension insurmontable entre universalisme et relativisme ?


 (0)
(0)

 (0)
(0)
Philippe Descola nous propose un aperçu de sa pensée des ontologies plurielles.
Il se positionne au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui le "tournant ontologique en anthropologie", et retrace la généalogie de ses idées et les influences dont il se revendique, du structuralisme de Lévi-Strauss au perspectivisme de Viveiros de Castro.
Dans un deuxième temps, il répond aux questions de la salle en explicitant sa vision de l'homme, de l'anthropologie, et en expliquant le but des structures explicatives et prédictives qu'il propose dans "Par-delà Nature et culture" et dans le reste de son œuvre, différentes à ses yeux de ce que peut offrir l'anthropologie cognitive de laquelle il se démarque.
Il esquisse enfin les grandes lignes de ce qu'il comprendre du pluralisme en anthropologie.