

 (0)
(0)
L'aspect politique de la langue que nous utilisons est très souvent oublié.
En effet, notre langue est tout sauf un donné naturel. Réfléchir à notre identité et vouloir persévérer dans notre être social -français!- revient à s'interroger sur les possibilités de défense de notre belle langue, condition indispensable pour continuer à faire société.


 (0)
(0)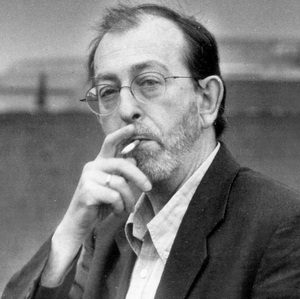
Le politique est un domaine autonome, qui a ses règles propres.
Attaqué par les feux croisés du marché et du droit, fruits du déploiement de la logique libérale, il semble de moins en moins visible.
Comment comprendre que le politique, autrefois si flamboyant dans notre tradition européenne, soit aujourd'hui réduit à peau de chagrin ?


 (0)
(0)
Frédéric Mariez, fondateur du "mouvement matricien" et anthropologue autodidacte indépendant, a effectué des travaux pour comprendre pourquoi le matriarcat était un système familial adopté par les anciennes civilisations organiques avant la naissance des états.
Grâce à ses recherches et à ses expériences individuelles comme son récent voyage en Chine chez les mosos (un peuple pratiquant encore le matriarcat), il explique les avantages de cette organisation familiale si spécifique.
Une émission loin des clichés et du discours traditionnel, qui remettra en cause nombre de préjugés sur la famille nucléaire.


 (0)
(0)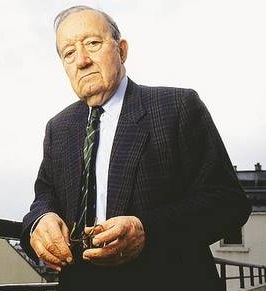
A bientôt soixante-dix ans de distance, comment imaginer que, sans contrainte et même aux applaudissements d’une partie des Français, aient pu surgir dans presque tous les départements de l’ancienne zone libre, en Ariège, en Ardèche, en Dordogne, en Haute-Garonne, dans la Lozère, la Haute-Savoie, le Gard, la Haute-Vienne, des tribunaux promis à une brève mais terrible existence ?
Henri Amouroux revient sur l’histoire des tribunaux du peuple, rarement évoquée, mais, selon lui, rest vivante dans bien des mémoires encore.


 (0)
(0)
Au travers de cet entretien du mois de décembre 2014, Pierre-Yves Rougeyron revient sur les sujets qui font l'actualité, et tente de délivrer des analyses qui s'expliquent par les tendances lourdes qui agitent notre époque.
De l’affaire des crèches à la question de la laïcité, du problème de la souveraineté aux débats sur les formes politiques (républicanisme, monarchie), de l'hypothétique remigration à la question géopolitique de la reprise des relations États-Unis/Cuba, Pierre-Yves Rougeyron nous dresse un tableau de l'état de la France et du monde.


 (0)
(0)

 (0)
(0)
Marion Sigaut s'attelle une nouvelle fois à démysthifier l'histoire en s'attaquant à l'épisode de la chasse au sorcières et à la séquence inquisitoriale, deux événement souvent (volontairement?) couplés et utilisés pour discréditer l'ancien régime et la foi catholique.
La conférencière nous rappelle d’entrée qu’elle n’est pas une spécialiste du Moyen Âge, et précise qu’elle vient rendre compte des recherches et des travaux réalisés par d’autres historiens parmi lesquels :
- Norman Cohn pour son livre "Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen Âge" édité chez Payot
- Robert Mandrou pour son livre "Magistrats et sorcier en France au XVIIe siècle" édité chez Seuil
- Jean Delumeau pour son livre "Le catholicisme entre Luther et Voltaire" co-écrit avec Monique Cottret, édité chez Puf


 (0)
(0)
La politique de l’ingérence en occident est dangereuse et radicale. C'est la position que Jean Bricmont soutient dans cette conférence.
Les points développés :
1. Donner les arguments en faveur du droit international classique qui reconnait l'égale souveraineté des nations.
2. L'effet de cette politique est désatreuse : des milliers de morts, l'extinction de l'espoir d'une transition démocratique, et l’ "effet barricade" (les mesures répressives surréalistes qui suivent ces moments de fièvre).
3. La gauche occidentale, étrangement, soutient régulièrement la politique d’ingérence (guerre en Lybie par exemple)
4. La crise de l’occident : la décolonisation est la plus grande transformation sociale du XXème siècle. La nouvelle donne nous oblige à abandonner nos vieux réflexes impérialistes et à repenser notre rapport aux autres civilisations.
Conférence organisée par la Maison Internationale des associations de Genève et l’Institut International pour la Paix, la Justice et les Droits de l’Homme.