

 (0)
(0)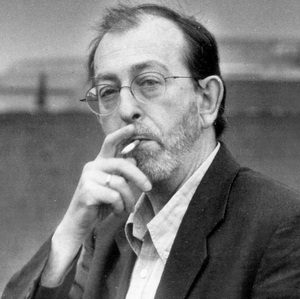
Il est difficile de définir le libéralisme, car on ne peut pas rattacher cette idéologie à un auteur unique. Elle est le fruit d’une longue construction théorique. En son essence, le libéralisme pose l’individu et ses libertés au centre du monde, et l’individu comme être antérieur à la société. La déclinaison économique de cette anthropologie est l’homo œconomicus, dont le but est de maximiser son intérêt bien compris.
Une conférence qui nous permet de saisir à quel point la conception libérale de l'homme règne aujourd'hui en maître dans le royaume des idées.


 (0)
(0)

 (0)
(0)
Le livre de Laurent Obertone est matière à réfléchir à l'état du fonctionnement de l'appareil judiciaire aujourd'hui en France.
Alors que la mode depuis les années 1950 est à la prévention et à l'individualisation des peines (école de la Défense sociale nouvelle de Marc Ancel), la criminalité a en même temps été multipliée par 7.
Comment comprendre cet "ensauvagement" de la société française ?


 (0)
(0)

 (0)
(0)
La "mondialisation" est un concept souvent mal compris, mal employé, et il est rarement défini avec précision. Tantôt encensée, tantôt accusée d’être responsable de tous les maux de l’humanité, la mondialisation est pourtant devenue un sujet central dans le discours politique.
Gilles Ardinat se propose d’aborder de façon simple ce phénomène complexe. En effet, loin de se limiter aux questions économiques, il nous rappelle la richesse du processus de mondialisation : aspects historiques, culturels, géopolitiques, juridiques, géographiques ou écologiques qui dépassent le seul cadre du commerce ou de la finance.
Il s’agit également de présenter les différentes controverses liées à cette question : crises à répétition, risque d’uniformisation des cultures, perte de souveraineté de certains États, "émergence" de nouvelles puissances...
Un point de vue intéressant qui nous permet de mieux penser la grande dynamique qu'est la "mondialisation".


 (0)
(0)
En France, est répandue depuis plus de 40 ans une histoire réactionnaire de la Révolution propagée des ouvrages "savants" aux manuels des écoliers. Ce déni, instrumentalisé par l'oligarchie qui l'a promu, s'accompagne d'une "haine de soi" qui suscite la perplexité goguenarde des historiens du monde entier.
Les conséquences grotesques de cette propension au "devoir de mémoire" patrimonial revendiqué contre l'intelligibilité du développement historique ont pourtant fini par disqualifier ces scolastes aux yeux de celles et ceux qui entendent faire de l'histoire quelque chose du présent, qui y cherchent une source généalogique de savoir et de sens.
Le magnifique travail de Sophie Wahnich atteste qu'une nouvelle génération d'historiens à donc su de ce passé récent "faire table rase", et nous restituer la portée sociale fondatrice et universelle de la Révolution, en révélant l'imposture des apories que 40 années de refoulement avaient postulé entre "sentiment et raison", "violence et progrès", "individu et collectivité".
En nous réappropriant, avec Sophie Wahnich, ce moment de notre histoire où l'être social de la Nation a réussi a s'exprimer, et pour toujours être entendu du monde entier, nous pouvons de nouveau en faire quelque chose, aujourd'hui, en ces temps obscurs de relativisme généralisé et de concurrence libre et non faussée, pour... en sortir !


 (0)
(0)
Le concept d' "aliénation" est depuis longtemps tombé en désuétude.
Pourtant, et à y regarder de plus près, il n'a peut être jamais été aussi performant que pour décrire notre monde toujours plus soumis à la logique libérale.
Charles Robin revient sur ces thèmes "michéens" pour continuer son analyse de notre société empêtrée dans ses contradictions libérales.


 (0)
(0)
Les aventures de la petite phrase, droit naturel, demeurent encore largement méconnues, bien qu’elles suscitent un intérêt réel et récent.
Le travail de Brian Tierney (1997) a permis de mieux situer sa réapparition dans des formes toutes nouvelles, à l’époque tumultueuse des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, et d’en suivre la renaissance à la lumière de l’Ecole de Salamanque jusqu’aux débuts du XVIIe siècle.
Florence Gauthier nous propose de revenir sur l’histoire de ce concept de droit, et sur ses potentialités révolutionnaires.