

 (0)
(0)
René Goscinny est l'un des auteurs français les plus lus au monde. À elles seules, les aventures d'Astérix le Gaulois, traduites en de multiples langues et dialectes, représentent près de 370 millions d'albums vendus !
René Goscinny était un homme tout le temps drôle. Dans ses écrits, dans ses propos. Ce n'était cependant pas un boute-en-train au sens habituel du terme. Toujours élégant, bouillonnant de l'envie de créer, il était courtois et, en même temps, très réservé.
Pendant lontemps, il aura tiré le diable par la queue et puis, aux abords de la quarantaine, il est devenu un auteur comblé et, enfin, un homme de bonheurs (sa femme, sa fille). Ensuite, trop vite, comme ces ballons sur lesquels il aimait tirer dans les fêtes foraines, son coeur a explosé. Il est mort à 51 ans, le 5 novembre 1977.
Pratiquant un art rare, dénué de méchanceté, de vulgarité, tout de légèreté et de précision, René Goscinny a été un immense scénariste de bande dessinée, un génie de l'écriture. Il a aussi été en 1959 le cofondateur (avec Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo) du journal Pilote où est née la bande dessinée que nous lisons encore aujourd'hui. De Bretécher à Bilal, en passant par Gotlib, Cabu, Tardi, Morris, Mézières, Druillet, Fred, Lob, Giraud, Christin, Pétillon, Sempé, Reiser, F'murrr, Lauzieret bien d'autres.
C'est la trajectoire de ce gentleman pudique, drôle, fragile et mystérieux que nous raconte Patrick Gaumer.


 (0)
(0)
Qu'est-ce que la civilisation, l'art, la culture ? En quoi ces questions nous éclairent-elles sur ce que nous sommes ou devrions être ? Suspectes de populisme parce qu'elles touchent au tabou de l'identité, elles sont aujourd'hui tenues pour illégitimes. Si on ose, cependant, les affronter, on sera conduit à reconsidérer l'art comme composante principale de la civilisation.
Comment subsisterait-elle alors qu'à l'art s'est substitué le non-art, effet de la mondialisation, qui, comme elle, n'admet aucune friction dans les flux planétaires de marchandises, d'hommes, d'informations ? Sa vacuité (il n'a pas de style) lui interdit toute appartenance à une tradition et son universalisme nihiliste l'enferme dans la négation de toute particularité, rien n'étant plus universel que le néant.
À l'intersection de l'histoire et de la philosophie, Kostas Mavrakis engage le débat avec les champions du libéralisme, de l'islamisme ou du prétendu "art contemporain", en mettant en lumière le lien paradoxal qui les unit.


 (0)
(0)
De Pasolini, les Français ont surtout retenu son oeuvre cinématographique. Mais en Italie, c'est le Pasolini poète qui est célébré. Poète, mais aussi romancier, critique d'art, engagé politique, Pasolini est extrême, excessif, scandaleux, mais jamais provocateur. Gare aux âmes sensibles !
En quatre temps, ces émissions nous emmènent aux limites du figurable avec le film Salò ou les 120 Journées de Sodome de Pasolini, dans sa poésie, ses écrits autobiographiques, et enfin sa pensée philosophique.
Émission "Les Chemins de la philosophie", animée par Adèle Van Reeth.


 (0)
(0)
Savions-nous que les débuts du communisme en URSS ont donné lieu à une véritable révolution artistique ? Car si en 1917, la révolution d'Octobre fait naître l'espoir d'une société nouvelle, celui-ci fut rapidement contrarié par l'exercice réel du pouvoir et l'arrivée de Staline, quelques années plus tard, à la tête du parti.
Les œuvres de Rodtchenko, Malevitch ou encore Klutsis relatent les tensions, les innovations plastiques et les contraintes idéologiques de cette époque...
Émission "Les histoires de l'art", animée par Marie-Thérèse Hablot.


 (0)
(0)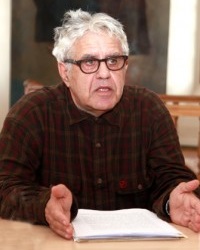
Professeur émérite, Gérard Conio est spécialiste de littérature russe. Ses inlassables efforts de traduction, d'édition et son implication dans l'organisation de nombreuses expositions ont permit au public francophone de mieux comprendre la production artistique et littéraire en Russie et sous le régime soviétique, notamment le mouvement nihiliste qui joua un grand rôle dans l'évolution intellectuelle de ce pays.
Émission du "Libre Journal d'Aude de Kerros".


 (0)
(0)
Tout au long de cette entretien exceptionnel illustré de nombreuses chansons, Georges Brassens nous parle de musique, bien sûr, mais aussi de la modernité, de son apprentissage de la musique, de l'art d'écrire des chansons, de son indifférence au confort, de son rapport aux femmes et à la religion, de son engagement militant ou encore du thème de la mort présent dans ses textes.
Il répète inlassablement ne pas se considérer comme poète et s'exprime constamment avec mesure, en restant pudique et délicat.
Un échange de haute volée avec un grand artiste, "quand même musicien un peu des mots aussi"...
Émission "Les samedis de France Culture", animée par Philippe Nemo.


 (0)
(0)
Quelle est l'origine de l'oeuvre d'art ? Et pourquoi ajouter des oeuvres d'art à la pléthore de beauté, d'invention, d'humour qu'offre le monde tel qu'il est ? La réflexion de George Steiner renouvelle la philosophie des valeurs en interrogeant les arts, c'est-à-dire ce qui met les valeurs à l'épreuve de la manière la plus immédiate.
Sous le double signe de la pensée pure et de l'approche critique sont interrogés les théories philosophiques de la création esthétique, de Platon et Aristote à Saint-Augustin, Nietzsche et Heidegger et les témoignages des artistes eux-mêmes.


 (0)
(0)
Depuis le début des années 1980, c'est-à-dire vraisemblablement à partir du moment où elles ont disparu, des milliers de pages ont été écrites sur les avant-gardes artistiques. Pourtant, personne n'avait encore tenté une synthèse comme celle que propose Béatrice Joyeux-Prunel.
Maître de conférences et chercheuse à l'Ecole normale supérieure en histoire de l'art contemporain, elle a entrepris, à l'aide de la sociologie, de l'histoire sociale de l'art et de nouvelles approches quantitatives permises par les outils informatiques, une première et ambitieuse histoire mondiale des avant-gardes artistiques.
Émission "La vie est un roman".