


 (1)
(1)
Le grand historien israélien Shlomo Sand revisite une histoire qui, de l'affaire Dreyfus à l'après-Charlie, lui apparaît comme celle d'une longue déchéance. Depuis ses années d'étude à Paris jusqu'à aujourd'hui, il a côtoyé le petit monde de la vie intellectuelle parisienne tout en sachant garder ses distances. Fort de cette expérience, il bouscule certains mythes attachés à cette figure de l'intellectuel, que la France s'enorgueillit d'avoir inventée.
Alors qu'il fut dans sa jeunesse un admirateur de Zola, Sartre et Camus, Shlomo Sand est aujourd'hui sidéré de voir ce que l'intellectuel parisien est devenu quand il s'incarne sous les traits de Michel Houellebecq, Éric Zemmour ou Alain Finkielkraut...
Au terme d'une analyse sans concession, où il s'interroge en particulier sur la judéophobie et l'islamophobie de nos "élites", il jette sur la scène intellectuelle française un regard à la fois désabusé et sarcastique.


 (0)
(0)
La famille est une institution fragile dont le droit a en quelque sorte la garde. Cela tient à ce qu'il intervient traditionnellement, avec le testament et avec le partage, en matière successorale, et, avec le contrat de mariage, en matière matrimoniale. Or, mariage et succession sont comme les clefs de la famille. Ce n'est pas que les questions de filiation, de nom et de bien de famille, de tutelle, d'obligation alimentaire, de secours ou de devoirs envers les parents (vivants et morts) soient négligeables : elles participent de la même institution ; mais elles découlent toutes, en définitive, du mariage et de la succession.
Aujourd'hui plus personne ne peut ignorer que l'institution de la famille fasse l'objet des attentions les plus contradictoires. Maître Damien Viguier fait avec nous la généalogie de cette crise de la famille en remontant, par l'histoire, aux sources anthropologiques de l'institution familiale, cellule de base de la société.


 (0)
(0)
Hannah Arendt naît en 1906, à Königsberg, dans une famille juive assimilée. L'adolescente rebelle commence par écrire des poèmes avant de découvrir l'éros philosophique avec Martin Heidegger et l'éthique de l'amitié avec Karl Jaspers. Mais l'ombre de l'antisémitisme s'abat sur l'Allemagne.
Après avoir été détenue par la Gestapo à Berlin en 1933, Hannah Arendt rejoint son mari, Günther Stern, à Paris, où elle aide des jeunes juifs à rejoindre la Palestine et s'éprend d'Heinrich Blücher. Raflée au Vel d'Hiv, puis internée au camp de Gurs, elle devient une "paria consciente".
Hannah Arendt et Heinrich Blücher débarquent en mai 1941 à New York. Une fois la guerre terminée, elle est déterminée à comprendre ce qui s'est passé. Elle rédige alors Les Origines du Totalitarisme, part en Allemagne identifier les biens juifs spoliés et couvre le procès d’Eichmann à Jérusalem. L'action devient le cœur de sa pensée.
Elle termine sa vie retirée, entourée de ses amis qu'elle appelle sa "tribu". Dans son Journal de pensée, elle expérimente un nouveau langage philosophique qui donne libre cours à son imagination. Sans esprit de système, Hannah Arendt laisse la pensée flotter "sans appui".
Hannah Arendt aura traversé le XXe siècle et construit son oeuvre entre deux continents géographiques et intellectuels, l'Europe et l'Amérique du Nord, la philosophie et la poésie.
Une série documentaire produite par Christine Lecerf et réalisée par Julie Beressi.


 (0)
(0)
L'antisémitisme fut largement répandu chez les socialistes français du XIXe siècle. Les écrits du célèbre utopiste Fourier abondent en remarques désobligeantes ou diffamatoires contre les Juifs, qui incarnent selon lui l'usure et le commerce. Quant à Proudhon, dont la judéophobie viscérale influencera nombre d'auteurs socialistes, il déclare que "le Juif est par tempérament antiproducteur... c'est un entremetteur, toujours frauduleux et parasite...".
De nombreux socialistes anticléricaux, marqués par le darwinisme social, reprochent aux Juifs d'avoir enfanté le christianisme. Le blanquiste Gustave Tridon, résolument raciste, estime ainsi que "Jésus est un juif, un Sémite ; les Sémites sont une race inférieure, un ensemble de peuples superstitieux qui ont imaginé des religions barbares, sanguinaires, oppressives."
Avant l'affaire Dreyfus, quelques socialistes commencent à réfléchir et à douter de la validité de l'antisémitisme, mais la plupart ne se ressaisissent véritablement qu'à partir de la fin du XIXe siècle, au moment où la judéophobie bascule à droite.
Cette petite anthologie, qui restitue dans leur contexte les écrits des propagandistes antijuifs s'inscrivant à gauche, bouscule les idées reçues en démontrant que les grands ancêtres du socialisme ont largement contribué à la naissance de l'antisémitisme moderne, également analysé dans le cadre de cette conférence.
Une conférence qui s'inscrit dans le "IVème séminaire international sur l'antisémitisme" installé au Centre de la Culture Contemporaine de Barcelone.


 (0)
(0)
Michel Drac, analyste politique et prospectiviste bien connu, s'emploie ici à dégager les lignes de forces des affrontements internationaux contemporains.
Les divers acteurs, les tendances lourdes et la structuration des conflits diplomatiques, des jeux d'influence et des conflits armés sont étudiés avec plusieurs notes de lecture sur des ouvrages consacrés à ces questions.


 (0)
(0)
Bien qu'elle structure leur inconscient collectif, les Français ne savent rien du fond de l'affaire Dreyfus et en particulier de sa dimension formidablement comique. Comique, l'Affaire ?
Le profane refusera sans doute de le croire. Pourtant, c'est la conclusion inéluctable à laquelle fait aboutir l'examen des éléments du dossier, au terme duquel apparaît un nombre sidérant de farces extraordinaires.
Mensonges éhontés, documents truqués, pièces falsifiées, faux et usage de faux, témoins achetés, magistrats corrompus, militaires retournés, journalistes menteurs, enquêtes "bidonnées", mises en scène grossières, ministres en service commandé, gouvernements aux ordres de l'Antifrance et collusions inavouables : tout, absolument tout, est trucage du côté dreyfusard.
S'il est vrai qu'Alfred Dreyfus n'aurait pas dû être condamné en 1894, notamment en raison de vice de forme, et qu'il n'était pas à proprement parler un traître, il reste coupable de fautes extrêmement graves justifiant sa condamnation devant le Conseil de guerre de Rennes en 1899.
Alfred Dreyfus, cependant, ne doit pas trop retenir notre attention, car la véritable Affaire, celle avec un grand A, est l'affaire Picquart-Esterhazy. Tout porte à croire en effet que ces deux personnages, présentés comme ennemis par l'histoire officielle, étaient, en réalité, des complice au service du Syndicat. L'affaire Picquart-Esterhazy n'est pas une affaire judiciaire, mais une lutte d'influence sans merci, opposant le camp de la France à celui de la Révolution, dans laquelle le tragique et le bouffon se disputent la première place.
L'enjeu majeur de l'Affaire n'est pas la libération d'Alfred Dreyfus, mais l'épuration de l'armée et du service de renseignement ; processus destructeur qui conduit fatalement à une catastrophe, à l'origine des hécatombes de 1914 : la nomination du général Joffre à la tête des armées françaises.
Émission "Quartier Libre", animée par Henry de Lesquen.
 (2)
(2)
Les "intellectuels" rouge-bruns ont tous une posture anti-système. Mais ce terme, en tant que tel, ne veut pas dire grand-chose. Car ces penseurs font référence à des idées de gauche pour finir par proposer des solutions réactionnaires en parvenant à berner de nombreuses personnes.
Chouard commence par une référence à la démocratie athénienne pour finir par une critique de la finance qui confine à l'antisémitisme. Zemmour fait fréquemment référence à Marx et se prétend l'ennemi d'un système qui, assez étrangement, le rémunère grassement. Son programme : la France du Maréchal Pétain. Quant à Soral qui se prétend anticapitaliste et même antiraciste, son discours ne contient rien d'autre que des saillies antisémites et antiféministes....
Petit panorama de la réaction actuelle qui avance masquée.


 (0)
(0)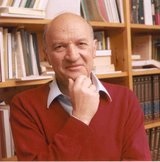
Le travail que nous présente Domenico Losurdo vise à démasquer l'idéologie dominante de la puissance dominante. Terrorisme, fondamentalisme, anti-américanisme, haine de l'Occident, complicité avec les islamistes et les antisémites : telles sont les armes que brandit l' " Empire du Bien" pour diaboliser tour à tour ses adversaires et mieux procéder ensuite à leur anéantissement.
Fondée par des propriétaires d’esclaves, des massacreurs d'Indiens et des théoriciens de la suprématie blanche, la prétendue " plus ancienne démocratie du monde " (Clinton) s'est toujours érigée en donneuse de leçons et en gendarme du monde. De nos jours, de Reagan à Obama, d'Abou Ghraib à Guantanamo, de la terreur nucléaire à l'agent orange, du soutien aux régimes fascistes aux enlèvements arbitraires de la CIA, de l'espionnage à la propagande, quiconque entend s'opposer à la puissante machine de guerre étasunienne devient automatiquement l'ennemi de la paix et de la civilisation.