

 (1)
(1)
Ils étaient 1'674 parlementaires représentant l'Allemagne sous la république de Weimar. Ils ont vécu la destruction d'une démocratie éclatante et le triomphe d'un régime politique criminel qui justifia l'invention du mot "génocide". Quelles ont été leurs responsabilités dans ce tournant du siècle ? Comment ces femmes et ces hommes ont-ils traversé la catastrophe allemande ?
Nicolas Patin a longuement étudié les archives allemandes et internationales pour comprendre les parcours de chacune de ces personnalités. Son enquête décrypte les destins atypiques de ces élus du peuple allemand : simples soldats de la Première Guerre mondiale puis militants politiques, martyrs assassinés dans les camps ou bourreaux nazis dominant l’Europe occupée.
Son travail met au jour la terrible conquête des institutions par les nazis et la funeste transformation de la société allemande.


 (0)
(0)
"J'ai désiré en finir une bonne fois avec la bêtise qui englue la question Céline. Bêtise des anticéliniens et bêtise des céliniens, cécité de Sartre et bêtise rebattue de Rebatet, bêtise maximale des antisémites et bêtise râleuse des moralisateurs...
On a beaucoup écrit sur l'épineux cas Céline, de très bonnes choses parfois - rarement, qu'on se rassure -, mais il semble que nul n'ait traité la question en adoptant une position fondamentalement littéraire (ni historique, ni universitaire, ni psychanalytique, ni éthique, ni critique), en laissant autrement dit le texte de Céline penser la position spiralée de Céline.
Prenant le parti de laisser le génie de Céline éclairer son propre parcours, j'ai découvert que du Voyage jusqu'à Rigodon, en passant par les pamphlets, Céline a su et a dit quel était son rapport à la question juive. Non point contre, mais face à face. Face à la Bible, et surtout face à Proust.
Lecteur, la guerre est déclarée, il faut choisir ton camp. Non pas : Céline ou les juifs, mais : Céline, les juifs et la littérature, ou bien le reste du monde." Stéphane Zagdanski
Un entretien mené par Christine Lecerf.
 (1)
(1)

 (0)
(0)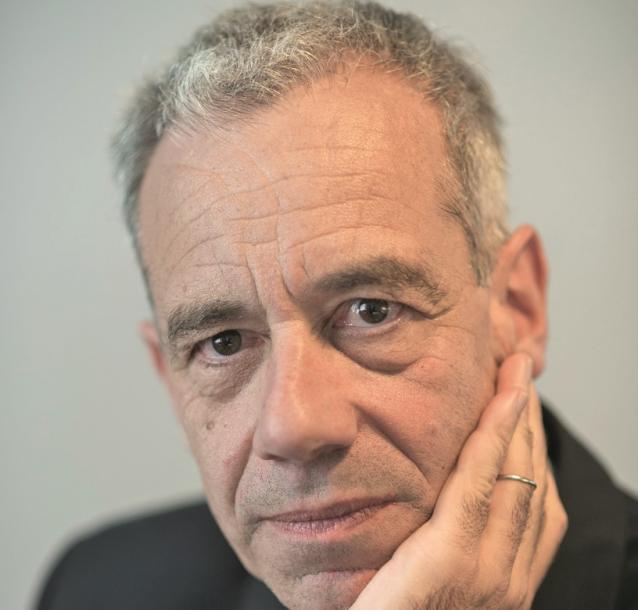
Cette émission en deux partie commence par tracer le portrait d'un homme politique majeure de la IIIe République, esprit original et visionnaire, tombé dans l'oubli. Maxime Tandonnet revient sur le parcours politique d'André Tardieu qui dirigea plusieurs gouvernements entre novembre 1929 et mai 1932 et qui, incapable de mener à bien les réformes qu'il estimait nécessaires pour la France face aux périls d'alors, rédigea l'essai Le souverain captif, plus que jamais d'actualité.
La deuxième partie est consacrée au mouvement d'Action française de l'entre-deux-guerres qui eu la particularité de s'opposer radicalement à la fois au "germanisme" et au national-socialisme. Cette vision maurrassienne du nazisme est ce que nous propose de découvrir Michel Grunewald, nourrie des leçons de Fichte prodiguées à la "nation allemande" à l'heure de la domination napoléonienne.
Émission du "Libre Journal des débats", animée par Charles de Meyer.


 (0)
(0)
Louis-Ferdinand Céline demeure un hapax dans notre littérature et notre culture nationale. Plus de cinquante ans après sa mort, il hante et divise toujours les esprits. Il est ce créateur antisémite, cet artiste collaborationniste, qui a révolutionné la langue avec Voyage au bout de la nuit et mis sa plume au service de l'abjection dans Bagatelles pour un massacre. Céline emporte, dégoûte, fascine et scandalise.
En 2011, il est retiré de la liste des célébrations nationales. En 2017, le projet de publication de ses pamphlets chez Gallimard est suspendu. Entre le génie et le salaud, l'homme et son œuvre, où sont les frontières ?
Cette grande traversée propose d’aller jusqu'au fond de la nuit, là où comme Céline l'écrit "tout est trouble, équivoque, avant de verser dans le noir".
Une série documentaire produite par Christine Lecerf et réalisée par Franck Lilin.


 (0)
(0)
"C'en était fait de l'idylle entre François-Marie Arouet et moi : Adieu Zadig, adieu Candide, adieu Micromegas ! Mon ancienne admiration je l'assigne à résidence en mes plus noirs souterrains, chargée de fers. Les ricanements squelettiques venus du tréfonds de mes oubliettes me laisseront de marbre. Je resterai inflexible sur ma plus haute tour de guet antisémite. Au loin, de sombres lueurs rougeoient les murs du château de Ferney, comme s'il était un Four crématoire champêtre, du sang suinte de ses murs sous les doigts crochus du lierre, le Zyclon sue par ses fentes et ses fissures, et les bougies des grands candélabres que l'on aperçoit l'été par les croisées ouvertes, exsudent une abjecte odeur de suif."
Telle sera la condamnation sans appel que la Révélation de l'antisémitisme de Voltaire fera prononcer par Félix Niesche qui, naguère encore, louait l'élégance, la finesse et l'ironie d'une œuvre qu'il jugeait irremplaçable pour combattre l'imbécilité, la platitude, la vulgarité irrationnelle de nos temps. Mais l'antisémitisme de Voltaire passe la mesure !
La plupart de ses œuvres en sont remplies, le Dictionnaire philosophique croule littéralement sous un flot d'antisémitisme continu. Voltaire n'est pas un peu antijuif sur les bords, antijudaïque par-dessus le marché, mais il est ontologiquement, radicalement antisémite, au sens moderne du mot. Dans l'Essai sur les mœurs, il déplore que les Juifs "furent punis, mais moins qu'ils ne le méritaient, puisqu'ils subsistent encore". Donc un authentique regret qu'il n'y eût point une Shoah avant la lettre.
C’est ce Voltaire interdit que nous découvrons ici.
Émission "Pourquoi tant de haine ?", animée par Monsieur K.


 (0)
(0)
Axel Tisserand nous présente le coeur de l'oeuvre de Charles Maurras : sa philosophie de l'homme et de la cité. Il aborde les problèmes contemporains en montrant comment l'anthropologie politique de Maurras, nourrie des principes aristotélo-thomistes, peut permettre de discerner les impasses de notre temps (transhumanisme, gender, relation de l'homme et de la femme), et de les surmonter.
Charles Maurras - le "scribe consciencieux" et le "guetteur mélancolique" a mis au point cette vision de l'être fini (et donc ouvert à la transcendance) et sait bien que le mépris de la finitude mène, à terme, à l'autodestruction au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
Une vision qui doit permettre aux jeunes esprits, amoureux de la vérité et avides de servir le bien commun, égarés dans ce monde, d'avoir une nourriture à leur faim.
Émission "Le monde de la philosophie", animée par Rémi Soulié.


 (0)
(0)
À l'occasion des 80 ans du déclenchement d'un conflit mondial qui permit au nazisme d'exterminer deux tiers des juifs d'Europe, cette série de deux émissions retrace, dans un premier temps, l'histoire du processus de destruction des juifs d'Europe à partir de l'ouvrage du même nom de Raoul Hilberg, et revient dans un second temps sur les origines de cette extermination : ses causes lointaines (notamment l'antisémitisme) et immédiates, sa spécificité et sa comparaison avec d'autres crimes de masse.
En effet, cette question a nourri d'innombrables débats entre historiens où les intentionnalistes, pour qui le génocide a été prévu et planifié, s'opposent aux fonctionnalistes, qui tentent de montrer que ce fut plutôt le fruit des circonstances.
Émission "Sortir du capitalisme", animée par Armel Campagne.